Les principes du naturalisme de Zola
Zola, Les Romanciers naturalistes, 1881
Le premier caractère du roman naturaliste, dont Madame Bovary est le type, est la reproduction exacte de la vie, l’absence de tout élément romanesque. La composition de l’œuvre ne consiste plus que dans le choix des scènes et dans un certain ordre harmonique de développements. Les scènes sont elles-mêmes les premières venues : seulement, l’auteur les a soigneusement triées et équilibrées, de façon à faire de son ouvrage un monument d’art et de science. C’est de la vie exacte donnée dans un cadre admirable de facture. Toute invention extraordinaire en est donc bannie. On n’y rencontre plus des enfants marqués à leur naissance, puis perdus, pour être retrouvés au dénouement. Il n’y est plus question de meubles à secret, de papiers qui servent, au bon moment, à sauver l’innocence persécutée. Même toute intrigue manque, si simple qu’elle soit. Le roman va devant lui, contant les choses au jour le jour, ne ménageant aucune surprise, offrant tout au plus la matière d’un fait divers ; et, quand il est fini, c’est comme si l’on quittait la rue pour rentrer chez soi. Balzac, dans ses chefs-d’œuvre : Eugénie Grandet, Les Parents pauvres, Le Père Goriot, a donné ainsi des images d’une nudité magistrale, où son imagination s’est contentée de créer du vrai. Mais, avant d’en arriver à cet unique souci des peintures exactes, il s’est longtemps perdu dans les inventions les plus singulières, dans la recherche d’une terreur et d’une grandeur fausses ; et l’on peut même dire que jamais il ne se débarrassa tout à fait de son amour des aventures extraordinaires, ce qui donne à une bonne moitié de ses œuvres l’air d’un rêve énorme fait tout haut par un homme éveillé.
Où la différence est plus nette à saisir, c’est dans le second caractère du roman naturaliste. Fatalement, le romancier tue les héros, s’il n’accepte que le train ordinaire de l’existence commune. Par héros, j’entends les personnages grandis outre mesure, les pantins changés en colosses. Quand on se soucie peu de la logique, du rapport des choses entre elles, des proportions précises de toutes les parties d’une œuvre, on se trouve bientôt emporté à vouloir faire preuve de force, à donner tout son sang et tous ses muscles au personnage pour lequel on éprouve des tendresses particulières. De là, ces grandes créations, ces types hors-nature, debout, et dont les noms restent. Au contraire, les bonshommes se rapetissent et se mettent à leur rang, lorsqu’on éprouve la seule préoccupation d’écrire une œuvre vraie, pondérée, qui soit le procès-verbal fidèle d’une aventure quelconque. Si l’on a l’oreille juste en cette matière, la première page donne le ton des autres pages, une tonalité harmonique s’établit, au-dessus de laquelle il n’est plus permis de s’élever, sans jeter la plus abominable des fausses notes. On a voulu la médiocrité courante de la vie, et il faut y rester. La beauté de l’œuvre n’est plus dans le grandissement d’un personnage, qui cesse d’être un avare, un gourmand, un paillard, pour devenir l’avarice, la gourmandise, la paillardise elles-mêmes ; elle est dans la vérité indiscutable du document humain, dans la réalité absolue des peintres où tous les détails occupent leur place, et rien que cette place. Ce qui tiraille presque toujours les romans de Balzac, c’est le grossissement de ses héros ; il ne croit jamais les faire assez gigantesques ; ses poings puissants de créateur ne savent forger que des géants. Dans la formule naturaliste, cette exubérance de l’artiste, ce caprice de composition promenant un personnage d’une grandeur hors nature au milieu de personnages nains, se trouve forcément condamné. Un égal niveau abaisse toutes les têtes, car les occasions sont rares où l’on ait vraiment à mettre en scène un homme supérieur.
J’insisterai enfin sur un troisième caractère. Le romancier naturaliste affecte de disparaître complètement derrière l’action qu’il raconte. Il est le metteur en scène caché du drame. Jamais il ne se montre au bout d’une phrase. On ne l’entend ni rire ni pleurer avec ses personnages, pas plus qu’il ne se permet de juger leurs actes. C’est même cet apparent désintéressement qui est le trait le plus distinctif. On chercherait en vain une conclusion, une moralité, une leçon quelconque tirée des faits. Il n’y a d’étalés, de mis en lumière, uniquement que les faits, louables ou condamnables. L’auteur n’est pas un moraliste, mais un anatomiste qui se contente de dire ce qu’il trouve dans le cadavre humain. Les lecteurs concluront, s’ils le veulent, chercheront la vraie moralité, tâcheront de tirer une leçon du livre. Quant au romancier, il est tient à l’écart, surtout par un motif d’art, pour laisser à son œuvre son unité impersonnelle, son caractère de procès-verbal écrit à jamais sur le marbre. Il pense que sa propre émotion gênerait celle de ses personnages, que son jugement atténuerait la hautaine leçon des faits. C’est là toute une poétique nouvelle dont l’application change la face du roman. Il faut se reporter aux romans de Balzac, à sa continuelle intervention dans le récit, à ses réflexions d’auteur qui arrivent à toutes les lignes, aux moralités de toutes sortes qu’il croit devoir tirer de ses œuvres. Il est sans cesse là, à s’expliquer devant les lecteurs. Et je ne parle pas des digressions. Certains de ses romans sont une véritable causerie avec le public, quand on les compare aux romans naturalistes de ces vingt dernières années, d’une composition si sévère et si pondérée.
Balzac est encore pour nous, je le répète, une puissance avec laquelle on ne discute pas. Il s’impose, comme Shakespeare, par un souffle créateur qui a enfanté tout un monde. Ses œuvres, taillées à coups de cognée, à peine dégrossies le plus souvent, offrant le plus étonnant mélange du sublime et du pire, restent quand même l’effort prodigieux du plus vaste cerveau de ce siècle. Mais, sans le diminuer, je puis dire ce que Gustave Flaubert a fait du roman après lui : il l’a débarrassé de l’enflure fausse des personnages, l’a changé en une œuvre d’art harmonique, impersonnelle, vivant de sa beauté propre, ainsi qu’un beau marbre. Telle est l’évolution accomplie par l’auteur de MadameBovary.
Textes de Zola issus de La Débacle (1892)
Lors de la guerre de 1870 contre la Prusse, les hommes du lieutenant Rochas, parmi lesquels le caporal Jean Macquart et Maurice Levasseur, font retraite vers Sedan, qui capitulera quelques jours plus tard, marquant la défaite de la France. Guidés par Henriette, la sœur de Maurice, ils parviennent à une propriété, l’Ermitage.
– Texte 1
Lorsque Maurice et Henriette, que suivaient les autres, eurent tourné à gauche, puis à droite, entre deux interminables murailles, ils débouchèrent tout d’un coup devant la porte grande ouverte de l’Ermitage. La propriété, avec son petit parc, s’étageait en trois larges terrasses ; et c’était sur une de ces terrasses que le corps de logis se dressait, une grande maison carrée, à laquelle conduisait une allée d’ormes séculaires. En face, séparées par l’étroit vallon, profondément encaissé, se trouvaient d’autres propriétés, à la lisière d’un bois. [...]Comme la jeune femme se hasardait dans la grande allée, elle recula, devant le cadavre d’un soldat prussien.
« Fichtre ! s’écria Rochas, on s’est donc cogné déjà par ici ! »
Tous alors voulurent savoir, poussèrent jusqu’à l’habitation ; et ce qu’ils virent les renseigna : les portes et les fenêtres du rez-de-chaussée avaient dû être enfoncées à coups de crosse, les ouvertures bâillaient sur les pièces tandis que des meubles, jetés dehors, gisaient sur le gravier de bas du perron. Il y avait surtout là tout un meuble de salon bleu ciel, le canapé et les douze fauteuils, rangés au petit bonheur, pêle-mêle, autour d’un grand guéridon, dont le marbre blanc s’était fendu. Et des zouaves, des chasseurs, des soldats de la ligne, d’autres appartenant à l’infanterie de marine, couraient derrière les bâtiments et dans l’allée, lâchant des coups de feu sur le petit bois d’en face, par-dessus le vallon.
« Mon lieutenant, expliqua un zouave à Rochas, ce sont des salauds de Prussiens, que nous avons trouvés en train de tout saccager ici. Vous voyez, nous leur avons réglé leur compte... Seulement, les salauds reviennent dix contre un, ça ne va pas être commode. »
Une bataille va alors s’engager.
– Texte 2
Rochas, cependant, triomphait. Autour de lui, le feu des quelques soldats, qu’il excitait de sa voix tonnante, avait pris une telle vivacité, à la vue des Prussiens, que ceux-ci, reculant, rentraient dans le petit bois.
« Tenez ferme, mes enfants ! ne lâchez pas !... Ah ! les capons, les voilà qui filent ! nous allons leur régler leur compte ! »
Et il était gai, et il semblait repris d’une confiance immense. Il n’y avait pas eu de défaites. Cette poignée d’hommes, en face de lui, c’étaient les armées allemandes, qu’il allait culbuter d’un coup, très à l’aise. Son grand corps maigre, sa longue figure osseuse, au nez busqué, tombant dans une bouche violente et bonne, riait d’une allégresse vantarde, la joie du troupier qui a conquis le monde entre sa belle et une bouteille de bon vin.
« Parbleu ! mes enfants, nous ne sommes là que pour leur foutre une raclée... Et ça ne peut pas finir autrement. Hein ? ça nous changerait trop, d’être battus !... Battus ! est-ce que c’est possible ? Encore un effort, mes enfants, et ils ficheront le camp comme des lièvres ! »
Il gueulait, gesticulait, si brave homme dans l’illusion de son ignorance, que les soldats s’égayaient avec lui. Brusquement, il cria :
« A coups de pied au cul ! à coups de pied au cul, jusqu’à la frontière !... Victoire, victoire ! »
Mais, à ce moment, comme l’ennemi, de l’autre côté du vallon, paraissait en effet se replier, une fusillade terrible éclata sur la gauche. C’était l’éternel mouvement tournant, tout un détachement de la garde qui avait fait le tour par le Fond de Givonne. Dès lors, la défense de l’Ermitage devenait impossible, la douzaine de soldats qui en défendaient encore les terrasses se trouvaient entre deux feux, menacés d’être coupés de Sedan. Des hommes tombèrent, il y eut un instant de confusion extrême. Déjà des Prussiens franchissaient le mur du parc, accouraient par les allées, en si grand nombre, que le combat s’engagea, à la baïonnette. Tête nue, la veste arrachée, un zouave, un bel homme à barbe noire, faisait surtout une besogne effroyable, trouant les poitrines qui craquaient, les ventres qui mollissaient, essuyant sa baïonnette rouge du sang de l’un, dans le flanc de l’autre ; et, comme elle se cassa, il continua, en broyant des crânes, à coups de crosse ; et, comme un faux pas le désarma définitivement, il sauta à la gorge d’un gros Prussien, d’un tel bond, que tous deux roulèrent sur le gravier, jusqu’à la porte défoncée de la cuisine, dans une embrassade mortelle. Entre les arbres du parc, à chaque coin des pelouses, d’autres tueries entassaient les morts. Mais la lutte s’acharna devant le perron, autour du canapé et des fauteuils bleu ciel, une bousculade enragée d’hommes qui se brûlaient la face à bout portant, qui se déchiraient des dents et des ongles, faute d’un couteau pour s’ouvrir la poitrine.
Et Gaude, avec sa face douloureuse d’homme qui avait eu des chagrins dont il ne parlait jamais, fut pris d’une folie héroïque. Dans cette défaite dernière, tout en sachant que la compagnie était anéantie, que pas un homme ne pouvait venir à son appel, il empoigna son clairon, l’emboucha, sonna au ralliement, d’une telle haleine de tempête, qu’il semblait vouloir faire se dresser les morts. Et les Prussiens arrivaient, et il ne bougeait pas, sonnant plus fort, à toute fanfare. Une volée de balles l’abattit, son dernier souffle s’envola en une note de cuivre, qui emplit le ciel d’un frisson.
Debout, sans pouvoir comprendre, Rochas n’avait pas fait un mouvement pour fuir. Il attendait, il bégaya :
« Eh bien ! quoi donc ? quoi donc ? »
Cela ne lui entrait pas dans la cervelle, que ce fût la défaite encore. On changeait tout, même la façon de se battre. Ces gens n’auraient-ils pas dû attendre, de l’autre côté du vallon, qu’on allât les vaincre ? On avait beau en tuer, il en arrivait toujours. Qu’est-ce que c’était que cette fichue guerre, où l’on se rassemblait dix pour en écraser un, où l’ennemi ne se montrait que le soir, après vous avoir mis en déroute par toute une journée de prudente canonnade ? Ahuri, éperdu, n’ayant jusque-là rien compris à la campagne, il se sentait enveloppé, emporté par quelque chose de supérieur, auquel il ne résistait plus, bien qu’il répétât machinalement, dans son obstination :
« Courage, mes enfants, la victoire est là-bas ! »
D’un geste prompt, cependant, il avait repris le drapeau. C’était sa pensée dernière, le cacher, pour que les Prussiens ne l’eussent pas. Mais, bien que la hampe fût rompue, elle s’embarrassa dans ses jambes, il faillit tomber. Des balles sifflaient, il sentit la mort, il arracha la soie du drapeau, la déchira, cherchant à l’anéantir. Et ce fut à ce moment que, frappé au cou, à la poitrine, aux jambes, il s’affaissa par minces lambeaux tricolores, comme vêtu d’eux. Il vécut encore une minute, les yeux élargis, voyant peut-être monter à l’horizon la vision vraie de la guerre, l’atroce lutte vitale qu’il ne faut accepter que d’un cœur résigné et grave, ainsi qu’une loi. Puis, il eut un petit hoquet, il s’en alla dans son ahurissement d’enfant, tel qu’un pauvre être borné, un insecte joyeux, écrasé sous la nécessité de l’énorme et impassible nature. Avec lui, finissait une légende.
Documents annexes (Textes écrits par Zola)
– Annexe 1 : Mon voyage à Sedan (Notes prises par Zola lors de son voyage sur les lieux de la bataille de Sedan)
« Mon Repos », dominé par un parc, s’étage en plusieurs terrasses : trois, je crois. La maison principale est bâtie sur une terrasse , avec une très belle allée de vieux arbres derrière. Plus bas, il y a encore un corps de logis. Au-dessous, le vallon se creuse encore, et de l’autre côté se trouve un petit bois, dans lequel étaient les Bavarois, qui avaient pris Bazeilles et Balan. Donc, en se retirant, des soldats français de toutes armes avaient pris ce jardin en étage pour redoute, se cachant derrière les gros arbres, faisant le coup de feu avec les Allemands d’en face. Evidemment, d’autres soldats ennemis durent tourner la propriété, et tomber sur les Français par la gauche. Le combat fut très meurtrier, car on releva près de quarante morts dans le jardin et le parc. Mais le détail terrible est que le propriétaire, venant le lendemain voir ce qu’était devenu son immeuble, constata du bout de l’allée qu’on avait sorti tous les meubles, des fauteuils et des canapés surtout ; et il resta stupéfait en voyant de loin des soldats français sur les sièges, dans des positions de gens endormis. Il s’approcha, et vit qu’ils étaient morts. En haut, dans le parc, on en releva vingt-sept. Dans le bâtiment, on retrouva un soldat français et un Bavarois, morts, enlacés dans une étreinte terrible. Comment avaient-ils pu rouler jusque là ? Un petit soldat de marine, qu’on enterra, l’œil emporté, sorti de l’orbite et sur lequel, lorsqu’on l’exhuma, on retrouva les lettres que j’ai eues entre les mains, horriblement maculées.
– Annexe 2 : Ebauche
Nos zouaves, nos chasseurs d’Afrique, nos légendes du petit pioupiou français qui enfonçait tout. Et par là-dessus le patriotisme à la Béranger, l’exécrable légende propagée par Horace Vernet, tout l’imagerie et la poésie chauvines, qui faisaient de nous les troupiers vainqueurs du monde. Beaucoup insister sur ce type légendaire du troupier français, qui devait être insupportable aux autres nations. Si l’on admet que la guerre est une chose grande et triste, une nécessité parfois terrible, à laquelle il ne faut jamais se décider que mûrement et gravement, quelle singulière attitude était la nôtre d’y aller en dansant, en chantant, en plaisantant, avec des refrains de goguettant. Notre attitude dans la dernière guerre était imbécile, et si quelque chose est mort à Sedan, que nous ne devions pas regretter, c’est cette légende coupable, le troupier ne rêvant que plaies et bosses, entre sa belle et un verre de bon vin. Personne ne veut plus la guerre, on s’y résignerait avec douleur, mais on n’est plus en train de courir les aventures. C’est au moins ça qu’on a gagné. Il n’y a plus que des fous qui promènent des drapeaux dans les rues. - Et, dès lors, incarner dans un personnage cet ancien esprit français de chauvinisme en goguette. A Berlin ! A Berlin ! L’idée qu’on a simplement à se présenter pour vaincre. Puis, l’immense stupeur après la première défaite. Eh ! Quoi ! on pouvait être vaincu ! et dès lors la débandade, l’écrasement. Et, à Sedan, mon personnage typique mourant dans un drapeau, comme un enfant ahuri et écrasé ; tandis que je fais se dresser la vision vraie de la guerre, abominable, la nécessité de la lutte vitale, toute l’idée haute et navrante de Darwin dominant le pauvre petit, un insecte écrasé dans la nécessité de l’énorme et sombre nature. La fin d’une légende.
– Annexe 3 : Science et patriotisme
Ce qu’il faut confesser très haut, c’est qu’en 1870 nous avons été battus par l’esprit scientifique. Sans doute l’imbécillité de l’Empire nous lançait sans préparation suffisante dans une guerre qui répugnait au pays. Mais est-ce que, dans des circonstances plus fâcheuses encore, la France d’autrefois n’a pas vaincu, lorsqu’elle manquait de tout, de troupes et d’argent ? C’est évidemment que l’ancienne culture française, la gaieté de l’attaque, les belles folies du courage suffisaient à assurer la victoire. En 1870, au contraire, nous nous sommes brisés contre la méthode d’un peuple plus lourd et moins brave que nous, nous avons été écrasés par des masses manœuvrées avec logique, nous nous sommes débandés devant une application de la formule scientifique à l’art de la guerre ; sans parler d’une artillerie plus puissante que la nôtre, d’un armement mieux approprié, d’une discipline plus grande, d’un emploi plus intelligent des voies ferrées. Eh bien ! je le répète, en face des désastres dont nous saignons encore, le véritable patriotisme est de voir que des temps nouveaux sont venus et d’accepter la formule scientifique, au lieu de rêver je ne sais quel retour en arrière dans les bocages littéraires de l’idéal. L’esprit scientifique nous a battus, ayons l’esprit scientifique avec nous si nous voulons battre les autres. Les grands capitaines aux mots sonores ne sont pas à regretter, si désormais les mots sonores ne doivent plus aider à la victoire.
La bataille de Waterloo
Victor Hugo, Les Misérables, IX, L’Inattendu
Ils étaient trois mille cinq cents. Ils faisaient un front d’un quart de lieue. C’étaient des hommes géants sur des chevaux colosses. [...]
L’aide de camp Bernard leur porta l’ordre de l’empereur. Ney tira son épée et prit la tête. Les escadrons énormes s’ébranlèrent.
Alors on vit un spectacle formidable.
Toute cette cavalerie, sabres levés, étendards et trompettes au vent, formée en colonne par division, descendit, d’un même mouvement et comme un seul homme, avec la précision d’un bélier de bronze qui ouvre une brèche, la colline de la Belle-Alliance, s’enfonça dans le fond redoutable où tant d’hommes déjà étaient tombés, y disparut dans la fumée, puis, sortant de cette ombre, reparut de l’autre côté du vallon, toujours compacte et serrée, montant au grand trot, à travers un nuage de mitraille crevant sur elle, l’épouvantable pente de boue du plateau de Mont Saint-Jean. Ils montaient, graves, menaçants, imperturbables ; dans les intervalles de la mousqueterie et de l’artillerie, on entendait ce piétinement colossal. Etant deux divisions, ils étaient deux colonnes ; la division Wathier avait la droite, la division Delord avait la gauche. On croyait voir de loin s’allonger vers la crête de plateau deux immenses couleuvres d’acier. Cela traversa la batille comme un prodige.
Rien de semblable ne s’était vu depuis la prise de la grande redoute de la Moskowa par la grosse cavalerie ; Murat y manquait, mais Ney s’y retrouvait. Il semblait que cette masse était devenue monstre et n’eût qu’une âme. Chaque escadron ondulait et se gonflait comme un anneau du polype. On les apercevait à travers une vaste fumée déchirée çà et là. Pêle-mêle de casques, de cris, de sabres, bondissement orageux des croupes des chevaux dans le canon et la fanfare, tumulte discipliné et terrible ; là-dessus les cuirasses, comme les écailles sur l’hydre.
Ces récits semblent d’un autre âge. Quelque chose de pareil à cette vision apparaissait sans doute dans les vieilles épopées orphiques racontant les hommes-chevaux, les antiques hippanthropes, ces titans à face humaine et à poitrail équestre dont le galop escalada l’Olympe, horribles, invulnérables, sublimes ; dieux et bêtes.
Bizarre coïncidence numérique, vingt-six bataillons allaient recevoir vingt-six escadrons. Derrière la crête du plateau, à l’ombre de la batterie masquée, l’infanterie anglaise, formée en treize carrés, deux bataillons par carré, et sur deux lignes, sept sur la première, six sur la seconde, la crosse à l’épaule, couchant en joue ce qui allait venir, calme, muette, immobile, attendait. Elle ne voyait pas les cuirassiers et les cuirassiers ne la voyaient pas. Elle écoutait monter cette marée d’hommes. Elle entendait le grossissement du bruit des trois mille chevaux, le frappement alternatif et symétrique des sabots au grand trot, le froissement des cuirasses, le cliquetis des sabres, et une sorte de grand souffle farouche. Il y eut un silence redoutable, puis, subitement, une longue file de bras levés brandissant des sabres apparut au-dessus de la crête, et les casques, et les trompettes, et les étendards, et trois mille têtes à moustaches grises criant : vive l’empereur ! toute cette cavalerie déboucha sur le plateau, et ce fut comme l’entrée d’un tremblement de terre.
Tout à coup, chose tragique, à la gauche des Anglais, à notre droite, la tête de colonne des cuirassiers se cabra avec une clameur effroyable. Parvenus au point culminant de la crête, effrénés, tout à leur furie et à leur course d’extermination sur les carrés et les canons, les cuirassiers venaient d’apercevoir entre eux et les Anglais un fossé, une fosse. C’était le chemin creux d’Ohain.
L’instant fut épouvantable. Le ravin était là, inattendu, béant, à pic sous les pieds des chevaux, profond de deux toises entre son double talus ; le second rang poussa le premier, et le troisième y poussa le second ; les chevaux se dressaient, se rejetaient en arrière, tombaient sur la croupe, glissaient les quatre pieds en l’air, pilant et bouleversant les cavaliers, aucun moyen de reculer, toute la colonne n’était plus qu’un projectile, la force acquise pour écraser les Anglais écrasa les Français, le ravin inexorable ne pouvait se rendre que comblé, cavaliers et chevaux y roulèrent pêle-mêle se broyant les uns sur les autres, ne faisant qu’une chair dans le gouffre, et, quand cette fosse fut pleine d’hommes vivants, on marcha dessus et le reste passa. Presque un tiers de la brigade Dubois croula dans cet abîme.
Ceci commença la perte de la bataille.[...]
D’autres fatalités encore devaient surgir.
Etait-il possible que Napoléon gagnât cette bataille ? Nous répondons non. Pourquoi ? A cause de Wellington ? A cause de Blücher ? Non. A cause de Dieu.
Bonaparte vainqueur à Waterloo, ceci n’était plus dans la loi du dix-neuvième siècle. Une autre série de faits de préparaient, où Napoléon n’avait plus de place. La mauvaise volonté des événements s’était annoncée de longue date.
Il était temps que cet homme vaste tombât.
L’excessive pesanteur de cet homme dans la destinée humaine troublait l’équilibre. Cet individu comptait à lui seul plus que le groupe universel. Ces pléthores de toute la vitalité humaine concentrée dans une seule tête, le monde montant au cerveau d’un homme, cela serait mortel à la civilisation si cela durait. Le moment état venu pour l’incorruptible équité suprême d’aviser. Probablement les principes et les éléments, d’où dépendent les gravitations régulières dans l’ordre moral comme dans l’ordre matériel se plaignaient. Le sang qui fume, le trop-plein des cimetières, les mères en larmes, ce sont des plaidoyers redoutables. Il y a, quand la terre souffre d’une surcharge, de mystérieux gémissements de l’ombre, que l’abîme entend.
Napoléon avait été dénoncé dans l’infini, et sa chute était décidée.
Il gênait Dieu.
Waterloo n’était point une bataille ; c’était le changement de front de l’univers.
Agrandissement épique et écriture naturaliste
Emile Zola, Lettre à Henri Céard, le 22 mars 1885, à propos de Germinal
Le second point, c’est mon tempérament lyrique, mon agrandissement de la vérité. Vous savez ça depuis longtemps, vous. Vous n’êtes pas stupéfait, comme les autres, de trouver en moi un poète. J’aurais aimé seulement vous voir démonter le mécanisme de mon œil. J’agrandis, cela est certain ; mais je n’agrandis pas comme Balzac, pas plus que Balzac n’agrandis comme Hugo. Tout est là, l’œuvre est dans les conditions de l’opération. Nous mentons tous plus ou moins, mais quelle est la mécanique et la mentalité de notre Mensonge ? Or - c’est ici que je m’abuse peut-être - je crois encore que je mens pour mon compte dans le sens de la vérité. J’ai l’hypertrophie du détail vrai, le saut dans les étoiles sur le tremplin de l’observation exacte. La vérité monte d’un coup d’aile jusqu’au symbole. Il y aurait là beaucoup à dire, et je voudrais un jour vous voir étudier le cas.
Le Salon de 1875
Emile Zola, Le Salon de 1875, Lettres de Paris, Une exposition de tableaux à Paris
– Texte 1
Avez-vous remarqué que les tableaux de bataille eux-mêmes se sont rapetissés jusqu’à pouvoir orner des tabatières ? Où est le temps où Yvon peignait des toiles colossales qu’on avait peine à caser au musée de Versailles ? Maintenant, nous en sommes tombés à l’épisode. Peut-être est-ce une conséquence de nos défaites. Notre peintre de bataille est à présent M. de Neuville, dont les grandes illustrations coloriées ont un succès fou. Cette année, ses deux toiles : Attaque par le feu d’une maison barricadée et crénelée et Une surprise aux environs de Metz, causent parmi la foule une émotion extraordinaire. Il y a réellement là de grandes qualités d’esprit, d’adresse, de décor en un mot ; mais c’est de la bien petite peinture, dans tous les sens.
– Texte 2
En traitant de la grande peinture, je n’ai rien dit des tableaux militaires. La raison en est que dans les dernières années, surtout depuis notre défaite, nos peintres de bataille dépeignent le plus souvent les épisodes sur une échelle très réduite. Je me souviens des immenses tableaux commandés par le gouvernement à Yvon après les guerres de Crimée et d’Italie ; pour trente ou quarante mètres de toile barbouillée on lui comptait cent mille francs. Et ces amples scènes, des champs de bataille complets, qui se trouvent maintenant au musée de Versailles, occupaient un mur entier dans la salle d’honneur de l’exposition. Aujourd’hui Yvon peint des portraits. Le coryphée de la peinture militaire, c’est maintenant Neuville, très doué pour la composition, et qui fait fureur avec ses reproductions d’épisodes de guerre, une douzaine de soldats se battant et mourant. C’est la peinture militaire transformée en peinture de genre. Le mérite de Neuville se borne à l’art avec lequel il dramatise un sujet. C’est un dessinateur et un illustrateur de première force. Quant à sa peinture, ce n’est que du barbouillage. C’est comme si vous étiez au cirque, au dernier acte d’une pièce quelconque, lorsque les groupes ingénieusement disposés soulèvent un tonnerre d’applaudissements dans la salle. Les femmes pleurent devant ses tableaux, les hommes serrent les poings. Jamais son art de bouleverser les spectateurs ne s’est montré de façon plus saisissante que dans sa composition de cette année : Attaque par feu d’une maison barricadée. Armée de l’Est. Villersexel, le 9 janvier 1871. Le village est déjà pris par les troupes du 18ème corps. Les Allemands établis dans la maison prolongent le feu. A gauche, la maison sombre, volets clos, entourée d’une poignée de soldats. La fumée se traîne devant la façade à chaque salve. En bas, gémissent les mourants. Et voici qu’à ce moment même les assiégeants sont en train de rouler jusqu’aux portes de la maison une charrette emplie de paille déjà enflammée. Cela produit une impression atroce. C’est un beau tableau, et qui remue en nous notre patriotisme blessé. Mais c’est tout.
Tableaux épiques représentant la guerre de 1871
– Edouard Detaille, Le Rêve, 1888
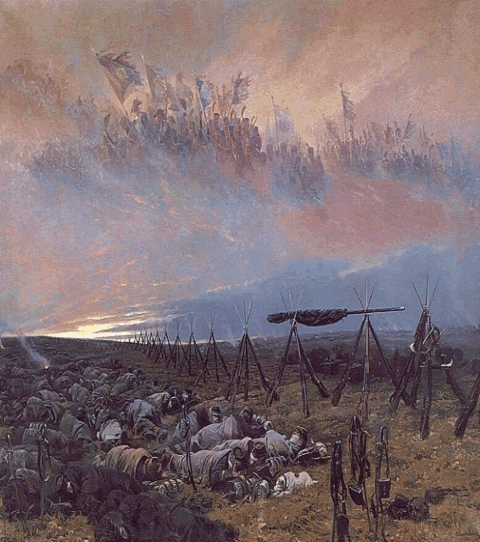
– Edouard Detaille, Cosaques attaqués par la Garde Royale, 1970

– Edouard Detaille, Mort du commandant Berbegier à la bataille de Saint-Privat, le 18 août 1870

– Alphonse-Marie de Neuville, Le Cimetière de Saint-Privas, le 18 août 1870, après 1870

– Alphonse-Marie de Neuville, Attaque d’une maison barricadée à Villersexel, 1875

Zola, La Faute de l’abbé Mouret,1875
Albine et Serge, un jeune prêtre, se promènent dans le parc du Paradou...
– Texte 1
Puis, Albine et Serge entrèrent jusqu’à la taille dans un champ de pivoines. Les fleurs blanches crevaient, avec une pluie de larges pétales qui leur rafraîchissaient les mains, pareilles aux gouttes larges d’une pluie d’orage. Les fleurs rouges avaient des faces apoplectiques, dont le rire énorme les inquiétait. Ils gagnèrent, à gauche, un champ de fuchsias, un taillis d’arbustes souples, déliés, qui les ravirent comme des joujoux du Japon, garnis d’un million de clochettes. Ils traversèrent ensuite des champs de véroniques aux grappes violettes, des champs de géraniums et de pélargoniums, sur lesquels semblaient courir des flammèches ardentes, le rouge, le rose, le blanc incandescent d’un brasier, que les moindres souffles du vent ravivaient sans cesse. Ils durent tourner des rideaux de glaïeuls, aussi grands que des roseaux, dressant des hampes de fleurs qui brûlaient dans la clarté, avec des richesses de flamme de torches allumées. Ils s’égarèrent au milieu d’un bois de tournesols, une futaie faite de troncs aussi gros que la taille d’Albine, obscurcie par des feuilles rudes, larges à y coucher un enfant, peuplée de faces géantes, de faces d’astre, resplendissantes comme autant de soleils. Et ils arrivèrent enfin dans un autre bois, un bois de rhododendrons, si touffu de fleurs que les branches et les feuilles ne se voyaient pas, étalant des bouquets monstrueux, des hottées de calices tendres qui moutonnaient jusqu’à l’horizon.
– Texte 2
C’était le jardin qui avait voulu la faute. Pendant des semaines, il s’était prêté au lent apprentissage de leur tendresse. Puis, au dernier jour, il venait de les conduire dans l’alcôve verte. Maintenant, il était le tentateur, dont toutes les voix enseignaient l’amour. Du parterre, arrivaient des odeurs de fleurs pâmées, un long chuchotement, qui contait les noces des roses, les voluptés des violettes ; et jamais les sollicitations des héliotropes n’avaient eu une ardeur plus sensuelle. Du verger, c’étaient des bouffées de fruits mûrs que le vent apportait, une senteur grasse de fécondité, la vanille des abricots, le musc des oranges. Les prairies élevaient une voix plus profonde, faite des soupirs des millions d’herbes que le soleil baisait, large plainte d’une foule innombrable en rut, qu’attendrissaient les caresses fraîches des rivières, les nudités des eaux courantes, au bord desquelles les saules rêvaient tout haut de désir. La forêt soufflait la passion géante des chênes, les chants d’orgue des hautes futaies, une musique solennelle, menant le mariage des frênes, des bouleaux, des charmes, des platanes, au fond des sanctuaires de feuillage ; tandis que les buissons, les jeunes taillis étaient pleins d’une polissonnerie adorable, d’un vacarme d’amants se poursuivant, se jetant au bord des fossés, se volant le plaisir, au milieu d’un grand froissement de branches. Et, dans cet accouplement du parc entier, les étreintes les plus rudes s’entendaient au loin, sur les roches, là où la chaleur faisait éclater les pierres gonflées de passion, où les plantes épineuses aimaient d’une façon tragique, sans que les sources voisines pussent les soulager, tout allumées elles-mêmes par l’astre qui descendait dans leur lit.
- Que disent-ils ? murmura Serge, éperdu. Que veulent-ils de nous, à nous supplier ainsi ?
Albine, sans parler, le serra contre elle.
[...]
Alors, Albine et Serge entendirent. Il ne dit rien, il la lia de ses bras, toujours plus étroitement. La fatalité de la génération les entourait. Ils cédèrent aux exigences du jardin. Ce fut l’arbre qui confia à l’oreille d’Albine ce que les mères murmurent aux épousées, le soir des noces.
Albine se livra. Serge la posséda.
Et le jardin entier s’abîma avec le couple, dans un dernier cri de passion. Les troncs se ployèrent comme sous un grand vent ; les herbes laissèrent échapper un sanglot d’ivresse ; les fleurs, évanouies, les lèvres ouvertes, exhalèrent leur âme ; le ciel lui-même, tout embrasé d’un coucher d’astre, eut des nuages immobiles, des nuages pâmés, d’où tombait un ravissement surhumain. Et c’était une victoire pour les bêtes, les plantes, les choses, qui avaient voulu l’entrée de ces deux enfants dans l’éternité de la vie. Le parc applaudissait formidablement.
Documents annexes (Textes écrits par Zola)
– Annexe 1 : Schéma du jardin du Paradou, issu du manuscrit de Zola pour La Faute de l’abbé Mouret
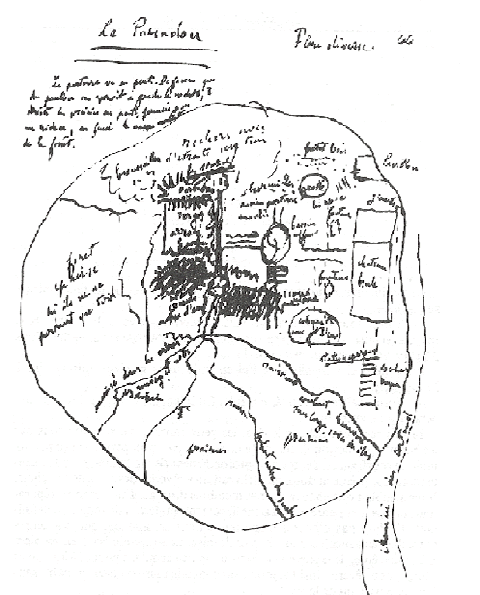
– Annexe 2 : Manuscrit de Zola pour La Faute de l’abbé Mouret
Un bois de tournesols. Buis
Ne Pas oublier les orties
Jasmin de Virginie (arbuste
Glycine de la Chine. - Le lierre
Acanthe du Portugal, à larges feuilles = Ageratum houpettes bleu céleste, bleu de ciel nain, bleuâtre lilacé rose = Agrostis une pluie de vert avec des pointes jaunes = Amarante crête-de-coq, cramoisi, violette, rouge, jaune, rose, à 3 couleurs, à feuilles rouges, gigantesque, queue de renard = Ancolie rose, violet sombre, blanche = Anémone, fleur de deuil < tragique > avec un pistil à grains noirs, bleuâtre, violâtre, jaunâtre = Asphodèle, bâton jaune d’or = Aperala sentant bon = Balsamine bleu foncé, feu, jaune paille, grlis de lin, fleur de pêche, blanc lavé de rose, rouge cuivré, couleur chair, ponctué de rose, cramoisi ponctué de blanc = Balsamines naines = Belles de jour, belles-de-nuit = Calendrinia en ombrelle = Campanules de toutes sortes (49) = Capucine = Chèvrefeuille = Clématites = Les Coquelourdes = Corbeille d’or, corbeille d’argent = Les Datura, violets, blancs = Digitales pourpres = Giroflées des murailles = Quarantaine = Les Glayeuls = Les Haricots d’Espagne = Hibiscus = les Iris = Les Juliennes = Mimulus ponctué, strié, cuivré, cinabre, musqué, cardinal, rose = Muguet = Myosotis = Œillets, dentelés, mignardise, toutes rouleurs = Roses trémières = Pensées à grandes macules = Pavot = Pervenche de Madagascar = Phlox, blanc et violet, pourpre noir, saumon, écarlate œil noir = Pieds d’alouette = Pivoines = Pois de senteur = Primevère frangée blanche, cuivrée, striée = Reines-marguerites = Renoncule = < Rose charnue, violâtre, rose panachée > = Réséda = Riesis sanguin = Scabieuse rose, lilas, pourpre étoilée = Sensitive = Souci = Tulipe = Véronique = Verveine = Violette = Volubilis = Zinnia blanc, violet, jaune, lilas, orange =
Oignons = Amaryllis : lis Saint-Jacques = Lis = Anémone = Jacinthes = Tubéreuses = Glaïeuls.
[N.B. : L’italique indique les noms biffés par Zola après qu’il les ait utilisés.]
Zola, Le Roman expérimental
Décrire n’est plus notre but ; nous voulons simplement compléter et déterminer. Par exemple, le zoologiste qui, en parlant d’un insecte particulier, se trouverait forcé d’étudier longuement la plante sur laquelle vit cet insecte, dont il tire son être, jusqu’à sa forme et sa couleur, ferait bien une description ; mais cette description entrerait dans l’analyse même de l’insecte, il y aurait là une nécessité de savant, et non un exercice de peintre. Cela revient à dire que nous ne décrivons plus pour décrire, par un caprice et un plaisir de rhétoricien. Nous estimons que l’homme ne peut être séparé de son milieu, qu’il est complété par son vêtement, par sa maison, par sa ville, par sa province ; et, dès lors, nous ne noterons pas un seul phénomène de son cerveau ou de son cœur, sans e chercher les causes ou le contrecoup dans le milieu. De là ce qu’on appelle nos éternelles descriptions.
Nous avons fait à la nature, au vaste monde, une place tout aussi large qu’à l’homme. Nous n’admettons pas que l’homme seul existe et que seul il importe, persuadés au contraire qu’il est un simple résultat, et que, pour avoir le drame humain réel et complet, il faut le demander à tout ce qui est. Je sais bien que ceci remue les philosophies. C’est pourquoi nous nous plaçons au point de vue scientifique, à ce point de vue de l’observation et de l’expérimentation, qui nous donne à l’heure actuelle les plus grandes certitudes possibles.
On ne peut s’habituer à ces idées, parce qu’elles froissent notre rhétorique séculaire. Vouloir introduire la méthode scientifique dans la littérature paraît d’un ignorant, d’un vaniteux et d’un barbare. Eh ! bon Dieu ! ce n’est pas nous qui introduisons cette méthode ; elle s’y est très bien introduite toute seule, et le mouvement continuerait, même si l’on voulait l’enrayer. Nous ne faisons que constater ce qui a lieu dans nos lettres modernes. Le personnage n’y est plus une abstraction psychologique, voilà ce que tout le monde peut coir. Le personnage y est devenu un produit de l’air et du sol, comme la plante ; c’est la conception scientifique. Dès ce moment, le psychologue doit se doubler d’un observateur et d’un expérimentateur, s’il veut expliquer nettement les mouvements de l’âme. Nous cessons d’être dans les grâces littéraires d’une description en beau style ; nous sommes dans l’étude exacte du milieu, dans la constatation des états du monde extérieur qui correspondent aux états intérieurs des personnages.
Je définirai donc la description : un état du milieu qui détermine et complète l’homme.
Deux lecteurs de La Faute de l’abbé Mouret de Zola
– Texte 1 : Barbey d’Aurevilly, Les Œuvres et les hommes, 1869
Son livre semble n’avoir pour but que de peindre la nature et d’exalter les forces physiques de la vie. C’est un livre d’intention scélérate, sous le désintéressement apparent de ses peintures. Il est tout simplement la vieille idée païenne, battue par le christianisme et revenant à la charge. C’est le naturalisme de la bête, mis sans honte et sans vergogne, au-dessus du noble spiritualisme chrétien !
Tel est le dessous et tel est le crapaud de ce livre. Tous ces gens qui ne comprennent rien au catholicisme, qu’ils ne savent pas et qu’ils n’ont point étudié, n’ont qu’une seule façon de procéder contre lui, mais cette façon ne manque jamais son coup sur les imbéciles. C’est l’attaque au prêtre et le déshonneur du prêtre. Le prêtre, autrefois, vivait de l’autel, et il n’existait que pour l’autel, mais à présent l’autel doit mourir par le prêtre... Et voilà pourquoi le prêtre, haï et méprisé, et dont on ne devrait même plus parler si les religions - comme ils le disent - étaient finies, tient tant de place dans l’irréligieuse littérature de ce temps.
Ainsi, première cause du succès de M. Zola : le déshonneur d’un prêtre catholique, qui jette sa soutane aux rosiers et fait l’amour comme les satyres le faisaient autrefois avec les nymphes, dans les mythologies... Cette malhonnêteté cinglée à la face de la sainte Eglise catholique, paraît très piquante à tous les libres-penseurs de cette époque d’impiété et de décadence ; mais il n’y a pas que cela qui fasse la fortune du livre de M. Zola. Il y a, dans La Faute de l’abbé Mouret, en dehors de son intention outrageante contre la religion, une autre cause de succès, bien plus générale, encore... Je l’ai dit plus haut, c’est la bassesse de l’inspiration. Je ne crois point que, dans ce temps de choses basses, on ait encore rien écrit de plus bas dans l’ensemble, les détails et la langue, que La Faute de l’abbé Mouret. C’est l’apothéose du rut universel dans la création. C’est la divinisation dans l’homme de la bête, c’est l’accouplement des animaux sur toute la ligne, avec une technique chauffée au désir de produire de l’effet, qui doit être le grand et peut-être le seul désir de M. Zola. Voilà ce qui fait de ce livre quelque chose d’une indécence particulière...Avec le XVIIIème siècle derrière nous, nous avions vu toutes sortes d’indécences. Nous avions eu l’indécence naïve, l’indécence voluptueuse, l’indécence polissonne, l’indécence cynique. Mais l’indécence scientifique nous manquant, et c’est M. Zola qui a l’honneur de nous la donner... Blasés sur toutes les autres, nus n’étions pas blasés sur celle-là. M. Emile Zola, du reste, convenait merveilleusement, de facultés et de goût, à cette besogne. Il n’a point d’idéal dans la tête, et comme son siècle, il aime les choses basses, signe du temps, et ne peut s’empêcher d’aller à elles.
– Texte 2 : Louis Desprez, L’Evolution naturaliste, 1884
Ce paradou - qui l’aurait cru ? - c’est le paradis terrestre, vierge et luxuriant, où Albine - l’Eve nouvelle - attend Serge, l’Adam nouveau. M. Zola a écrit beaucoup moins une étude de mœurs qu’un poème en prose. L’abbé Mouret n’est pas un vulgaire desservant, de race paysanne, au sang chaud, dont la chasteté succombe sous les attaques de la première Jeanneton venue. C’est l’ignorance de l’homme primitif conduite par l’astucieuse curiosité de la femme sous l’arbre de la faute. La vie représentée par Albine et par les végétations du Paradou lutte contre la mort, symbolisée par l’église où Serge se lamente et par l’épouvantable Archangias dans le dos duquel deux grandes ailes noires palpitent. Comme la foi d prêtre, le vieil édifice craque sous la poussée des plantes envahissantes. Les végétaux s’animent, agissent ; ils jettent Serge dans les bras d’Albine. Il y a dans les descriptions du Paradou un panthéisme débordant.
Zola et l’impressionnisme
– Texte 1 : Emile Zola, Mon Salon, (1868) : « Les Actualistes »
Je n’ai pas à plaider ici la cause des sujets modernes. Cette cause est gagnée depuis longtemps. Personne n’oserait soutenir, après les œuvres si remarquables de Manet et de Courbet, que le temps présent n’est pas digne du pinceau. Nous sommes, Dieu merci ! délivrés des Grecs et des Romains, nous avons même assez du Moyen Age que le romantisme n’est pas parvenu à ressusciter chez nous pendant plus d’un quart de siècle. Et nous nous trouvons en face de la seule réalité, nous encourageons malgré nous nos peintres à nous reproduire sur leurs toiles, tels que nous sommes, avec nos costumes et nos mœurs. [...]
Les peintres qui aiment leur temps du fond de leur esprit et de leur cœur d’artistes, entendent autrement les réalités. Ils tâchent avant tout de pénétrer le sens exact des choses ; ils ne se contentent pas de trompe-l’œil ridicules, ils interprètent leur époque en hommes qui la sentent vivre en eux, qui en sont possédés et qui sont heureux d’en être possédés. Leurs œuvres ne sont pas des gravures de mode banales et inintelligentes, des dessins d’actualité pareils à ceux que les journaux illustrés publient. Leurs œuvres sont vivantes, parce qu’ils les ont prises dans la vie et qu’ils les ont peintes avec tout l’amour qu’ils éprouvent pour les sujets modernes.
Parmi ces peintres, au premier rang, je citerai Claude Monet. Celui-là a sucé le lait de notre âge, celui-là a grandi et grandira encore dans l’adoration de ce qui l’entoure. Il aime les horizons de nos villes, les taches grises et blanches que font les maisons sur le ciel clair ; il aime, dans les rues, les gens qui courent, affairés, en paletots ; il aime les champs de course, les promenades aristocratiques où roule le tapage des voitures ; il aime nos femmes, leur ombrelle, leurs gants, leurs chiffons, jusqu’à leurs faux cheveux et leur poudre de riz, tout ce qui les rend filles de notre civilisation.
Dans les champs, Claude Monet préfèrera un parc anglais à un coin de forêt. Il se plaît à retrouver partout la trace de l’homme, il veut vivre toujours au milieu de nous. Comme un vrai Parisien, il emmène Paris à la campagne. Il ne peut peindre un paysage sans y mettre des messieurs et des dames en toilette. La nature paraît perdre de son intérêt pour lui, dès qu’elle ne porte pas l’empreinte de nos mœurs. [...]
J’ai vu de Claude Monet des toiles originales qui sont bien sa chair et son sang. L’année dernière, on lui a refusé un tableau de figures, des femmes en toilettes claires d’été, cueillant des fleurs dans les allées d’un jardin ; le soleil tombait droit sur les jupes d’une blancheur éclatante ; l’ombre tiède d’un arbre découpait sur les allées, sur les robes ensoleillées, une grande nappe grise. Rien de plus étrange comme effet. Il faut aimer singulièrement son temps pour oser un pareil tour de force, des étoffes coupées en deux par l’ombre et le soleil, des dames bien mises dans un parterre que le râteau d’un jardinier a soigneusement peigné.
Je l’ai déjà dit, Claude Monet aime d’un amour particulier la nature, que la main des hommes habille à la moderne. Il a peint une série de toiles prises dans des jardins. Je ne connais pas de tableaux qui aient un accent plus personnel, un aspect plus caractéristique. Sur le sable jaune des allées : les plates-bandes se détachent , piquées par le rouge vif des géraniums, par le blanc mat des chrysanthèmes. Les corbeilles se succèdent, toutes fleuries, entourées de promeneurs qui vont et viennent en déshabillé élégant. Je voudrais voir une de ces toiles au Salon ; mais il paraît que le jury est là pour leur en défendre soigneusement l’entrée. Qu’importe d’ailleurs ! elles resteront comme une des grandes curiosités de notre art, comme une des marques des tendances de l’époque.
Certes j’admirerais peu ces œuvres, si Claude Monet n’était un véritable peintre. J’ai simplement voulu constater la sympathie qui l’entraîne vers les sujets modernes. Mais si je l’approuve de chercher ses points de vue dans le milieu où il vit, je le félicite encore davantage de savoir peindre, d’avoir un œil juste et franc, d’appartenir à la grande école des naturalistes. Ce qui distingue son talent, c’est une facilité incroyable d’exécution, une intelligence souple, une compréhension vive et rapide de n’importe quel sujet. [...]
L’autre tableau dont je désire parler, est celui que Pierre-Auguste Renoir a intitulé Lise et qui représente une jeune femme en robe blanche, s’abritant sous une ombrelle. Cette Lise me paraît être la sœur de la Camille de Claude Monet. Elle se présente de face, débouchant d’une allée, balançant son corps souple, attiédi par l’après-midi brûlante. C’est une de nos femmes, une de nos maîtresses plutôt, peinte avec une grande vérité et une recherche heureuse du côté moderne.
– Texte 2 : Emile Zola, Une exposition : les peintres impressionnistes (1877)
Je crois qu’il faut entendre par des peintres impressionnistes des peintres qui peignent la réalité et qui se piquent de donner l’impression même de la nature, qu’ils n’étudient pas dans ses détails, ni dans son ensemble. Il est certain qu’à vingt pas on ne distingue nettement ni les yeux ni le nez d’un personnage. Pour le rendre tel qu’on le voit, il ne faut pas le peindre avec les rides de la peau, mais dans la vie de son attitude, avec l’air vibrant qui l’entoure. De là une peinture d’impression, et non une peinture de détails. Mais heureusement, en dehors de ces théories, il y a autre chose dans le groupe ; je veux dire qu’il y a de véritables peintres, des artistes doués du plus grand mérite.
Ce qu’ils ont de commun entre eux, je l’ai dit, c’est une parenté de vision. Ils voient tous la nature claire et gaie, sans le jus du bitume et de terre de Sienne des peintres romantiques. Ils peignent le plein air, révolution dont les conséquences seront immenses. Ils ont des colorations blondes, une harmonie de tons extraordinaires, une originalité d’aspect très grand. D’ailleurs, ils ont chacun un tempérament très différent et très accentué.
– Texte 3 : Emile Zola, Le naturalisme au Salon (1880)
Les véritables révolutionnaires de la forme apparaissent avec M. Edouard Manet, avec les impressionnistes, MM. Claude Monet, Renoir, Pissaro, Guillaumin, d’autres encore. Ceux-ci se proposent de sortir de l’atelier où les peintres se sont claquemurés depuis tant de siècles, et d’aller peindre en plein air, simple fait dont les conséquences sont considérables. En plein air, la lumière n’est plus unique, et ce sont dès lors des effets multiples qui diversifient et transforment radicalement les aspects des choses et des êtres. Cette étude de la lumière, dans ses mille décompositions et recompositions, est ce qu’on a appelé plus ou moins proprement l’impressionnisme, parce qu’un tableau devient dès lors l’impression d’un moment éprouvée devant la nature. Les plaisantins de la presse sont partis de là pour caricaturer le peintre impressionniste saisissant au vol des impressions, en quatre coups de pinceau informes ; et il faut avouer que certains artistes ont justifié malheureusement ces attaques, en se contentant d’ébauches trop rudimentaires. Selon moi, on doit bien saisir la nature dans l’impression d’une minute ; seulement, il faut fixer à jamais cette minute sur la toile, par une facture largement étudiée. En définitive, en dehors du travail, il n’y a pas de solidité possible. D’ailleurs, remarquez que l’évolution est la même en peinture que dans les lettres, comme je l’indiquais tout à l’heure. Depuis le commencement du siècle, les peintres vont à la nature, et par des étapes très sensibles. Aujourd’hui nos jeunes artistes ont fait un nouveau pas vers le vrai, en voulant que les sujets baignassent dans la lumière réelle du soleil, et non dans le jour faux de l’atelier ; c’est comme le chimiste, comme le physicien qui retourne aux sources, en se plaçant dans les conditions mêmes des phénomènes. Du moment qu’on veut faire de la vie, il faut bien prendre la vie avec son mécanisme complet. De là, en peinture, la nécessité du plein air, de la lumière étudiée dans ses causes et dans ses effets. Cela paraît simple à énoncer, mais les difficultés commencent avec l’exécution. Les peintres ont longtemps juré qu’il était impossible de peindre en plein air, ou simplement avec un rayon de soleil dans l’atelier, à cause des reflets et des continuels changements de jour. Beaucoup même continuent à hausser les épaules devant les tentatives des impressionnistes. Il faut être du métier effectivement pour comprendre tout ce que l’on doit vaincre, si l’on veut accepter la nature avec sa lumière diffuse et ses variations continuelles de colorations. A coup sûr, il est plus commode de maîtriser la lumière, d’en disposer à l’aide d’abat-jour et de rideaux, de façon à en tirer des effets fixes ; seulement, on reste alors dans la pure convention, dans une nature apprêtée, dans un poncif d’école. Et quelle stupéfaction pour le public, lorsqu’on le place en face de certaines toiles peintes en plein air, à des heures particulières ; il reste béant devant des herbes bleues, des terrains violets, des arbres rouges, des eaux roulant toutes les bariolures du prisme. Cependant, l’artiste a été consciencieux : il a peut-être, par réaction, exagéré un peu les tons nouveaux que son œil a constatés ; mais l’observation au fond est d’une absolue vérité, la nature n’a jamais eu la notation simplifiée et purement conventionnelle que les traditions d’école lui donnent. De là, les rires de la foule en face des tableaux impressionnistes, malgré la bonne foi et l’effort très naïf des jeunes peintres. On les traite de farceurs, de charlatans se moquant du public et battant la grosse caisse autour de leurs œuvres, lorsqu’ils sont au contraire des observateurs sévères et convaincus. Ce qu’on paraît ignorer, c’est que la plupart de ces lutteurs sont des hommes pauvres qui meurent à la peine, de misère et de lassitude. Singuliers farceurs que ces martyrs de leurs croyances !
Voilà donc ce qu’apportent les peintres impressionnistes : une recherche plus exacte des causes et des effets de la lumière, influant aussi bien sur le dessin que sur la couleur.
Quelques caricatures des peintres impressionnistes parues dans les journaux de l’époque
– Caricature 1 : Honoré Daumier, « Paysagiste au travail », Le Boulevard, 27 août 1862
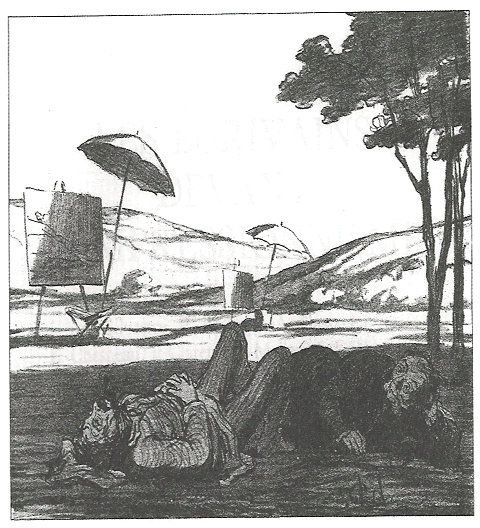
– Caricature 2 : Cham, Le Charivari, 22 avril 1877
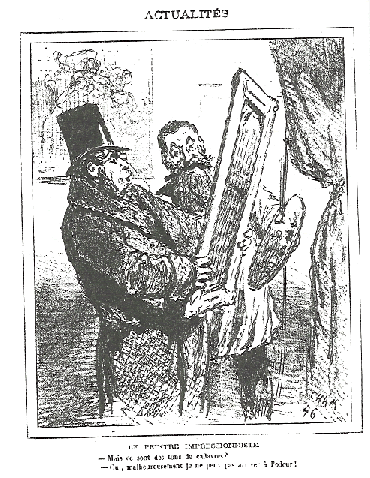
Le Peintre impressionniste
- Mais ce sont des tons de cadavre ?
- Oui, malheureusement je ne peux pas arriver à l’odeur !
– Caricature 3 : Cham, Le Charivari, 20 avril 1879
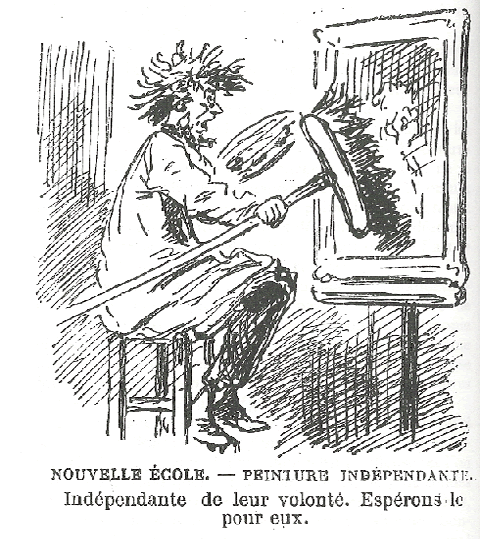
Nouvelle école. - Peinture indépendante.
Indépendante de leur volonté. Espérons le pour eux.
– Caricature 4 : Pif, Le Charivari, 10 avril 1881
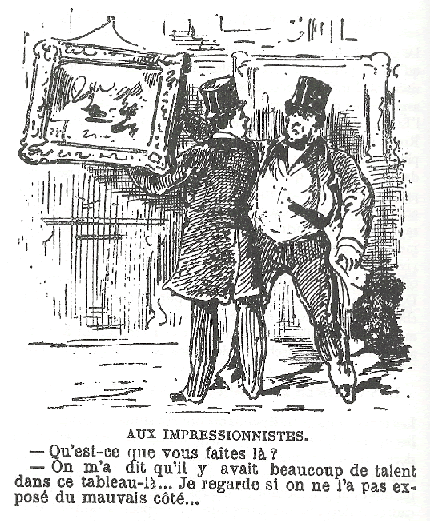
Aux Impressionnistes.
- Qu’est-ce que vous faites là ?
- On m’a dit qu’il y avait beaucoup de talent dans ce tableau-là... Je regarde si on ne l’a pas exposé du mauvais côté...
Quelques tableaux impressionnistes célébrés par Zola
– Monet, Femme à l’ombrelle, 1886

– Pierre-Auguste Renoir, Lise, 1867

– Renoir, La Balançoire, 1876

– Autres tableaux célébrés par Zola :
- Manet, La Musique aux Tuileries, 1862

- Monet, Femmes au jardin à Ville-d’Avray, 1866

- Monet, Jardin en fleurs, 1866
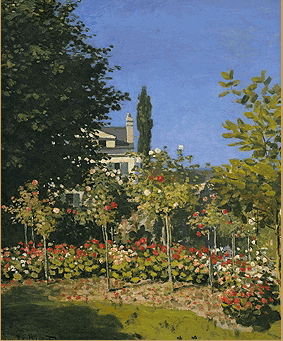
– Autres tableaux de Monet sur le thème du jardin :
- Monet, Jeanne-Marguerite Lecarde au jardin
- Monet, Glaïeuls,1876
- Monet, Les Tuileries, 1876
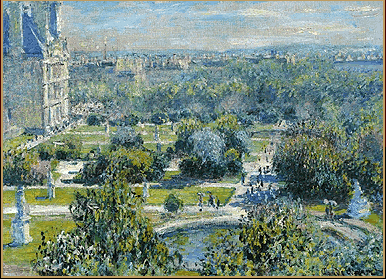
– Exemple de tableau romantique : Caspar David Friedrich, Le Voyageur au-dessus de la mer des nuages, 1818

Zola, L’Œuvre (1886)
Le peintre Claude Lantier expose ses théories sur la peinture à son ami et modèle Sandoz.
Ah ! qu’il les regrettait aujourd’hui, ces six mois d’imbéciles tâtonnements, d’exercices niais sous la férule d’un bonhomme dont la caboche différait de la sienne ! Il en arrivait à déclamer contre le travail au Louvre, il se serait, disait-il, coupé le poignet, plutôt que d’y retourner gâter son oeil à une de ces copies, qui encrassent pour toujours la vision du monde où l’on vit. Est-ce que, en art, il y avait autre chose que de donner ce qu’on avait dans le ventre ? est-ce que tout ne se réduisait pas à planter une bonne femme devant soi, puis à la rendre comme on la sentait ? est-ce qu’une botte de carottes, oui, une botte de carottes ! étudiée directement, peinte naïvement, dans la note personnelle où on la voit, ne valait pas les éternelles tartines de l’Ecole, cette peinture au jus de chique, honteusement cuisinée d’après les recettes ? Le jour venait où une seule carotte originale serait grosse d’une révolution. C’était pourquoi, maintenant, il se contentait d’aller peindre à l’atelier Boutin, un atelier libre qu’un ancien modèle tenait rue de la Huchette. Quand il avait donné ses vingt francs au massier, il trouvait là du nu, des hommes, des femmes, à en faire une débauche, dans son coin ; et il s’acharnait, il y perdait le boire et le manger, luttant sans repos avec la nature, fou de travail, à côté des beaux fils qui l’accusaient de paresse ignorante, et qui parlaient arrogamment de leurs études, parce qu’ils copiaient des nez et des bouches, sous l’œil d’un maître.
- Ecoute ça, mon vieux, quand un de ces cocos-là aura bâti un torse comme celui-ci, il montera me le dire, et nous causerons.
Du bout de sa brosse, il indiquait une académie peinte, pendue au mur, près de la porte. Elle était superbe, enlevée avec une largeur de maître ; et, à côté, il y avait encore d’admirables morceaux, des pieds de fillette, exquis de vérité délicate, un ventre de femme surtout, une chair de satin, frissonnante, vivante du sang qui coulait sous la peau. Dans ses rares heures de contentement, il avait la fierté de ces quelques études, les seules dont il fût satisfait, celles qui annonçaient un grand peintre, doué admirablement, entravé par des impuissances soudaines et inexpliquées.
Il poursuivit avec violence, sabrant à grands coups le veston de velours, se fouettant dans son intransigeance qui ne respectait personne :
- Tous des barbouilleurs d’images à deux sous, des réputations volées, des imbéciles ou des malins à genoux devant la bêtise publique ! Pas un gaillard qui flanque une gifle aux bourgeois !... Tiens ! le père Ingres, tu sais s’il me tourne sur le cœur, celui-là, avec sa peinture glaireuse ? Eh bien ! c’est tout de même un sacré bonhomme, et je le trouve très crâne, et je lui tire mon chapeau, car il se fichait de tout, il avait un dessin du tonnerre de Dieu, qu’il a fait avaler de force aux idiots qui croient aujourd’hui le comprendre... Après ça, entends-tu ! ils ne sont que deux, Delacroix et Courbet. Le reste, c’est de la fripouille... Hein ? le vieux lion romantique, quelle fière allure ! En voilà un décorateur qui faisait flamber les tons ! Et quelle poigne ! Il aurait couvert les murs de Paris, si on les lui avait donnés : sa palette bouillait et débordait. Je sais bien, ce n’était que de la fantasmagorie ; mais, tant pis ! ça me gratte, il fallait ça, pour incendier l’Ecole... Puis, l’autre est venu, un rude ouvrier, le plus vraiment peintre du siècle, et d’un métier absolument classique, ce que pas un de ces crétins n’a senti. Ils ont hurlé, parbleu ! ils ont crié à la profanation, au réalisme, lorsque ce fameux réalisme n’était guère que dans les sujets ; tandis que la vision restait celle des vieux maîtres et que la facture reprenait et continuait les beaux morceaux de nos musées... Tous les deux, Delacroix et Courbet, se sont produits à l’heure voulue. Ils ont fait chacun son pas en avant. Et, maintenant, oh ! maintenant...
Il se tut, se recula pour juger l’effet, s’absorba une minute dans la sensation de son oeuvre, puis repartit :
- Maintenant, il faut autre chose... Ah ! quoi ? je ne sais pas au juste ! Si je savais et si je pouvais, je serais très fort. Oui, il n’y aurait plus que moi... Mais ce que je sens, c’est que le grand décor romantique de Delacroix craque et s’effondre ; et c’est encore que la peinture noire de Courbet empoisonne déjà le renfermé, le moisi de l’atelier où le soleil n’entre jamais... Comprends-tu, il faut peut-être le soleil, il faut le plein air, une peinture claire et jeune, les choses et les êtres tels qu’ils se comportent dans de la vraie lumière, enfin je ne puis pas dire, moi ! notre peinture à nous, la peinture que nos yeux d’aujourd’hui doivent faire et regarder.
Sa voix s’éteignît de nouveau, il bégayait, n’arrivait pas à formuler la sourde éclosion d’avenir qui montait en lui. Un grand silence tomba, pendant qu’il achevait d’ébaucher le veston de velours, frémissant.
Sandoz l’avait écouté, sans lâcher la pose. Et, le dos tourné, comme s’il eût parlé au mur, dans un rêve, il dit alors à son tour :
- Non, non, on ne sait pas, il faudrait savoir... Moi, chaque fois qu’un professeur a voulu m’imposer une vérité, j’ai eu une révolte de défiance, en songeant : « Il se trompe ou il me trompe. » Leurs idées m’exaspèrent, il me semble que la vérité est plus large... Ah ! que ce serait beau, si l’on donnait son existence entière à une oeuvre, où l’on tâcherait de mettre les choses, les bêtes, les hommes, l’arche immense ! Et pas dans l’ordre des manuels de philosophie, selon la hiérarchie imbécile dont notre orgueil se berce ; mais en pleine coulée de la vie universelle, un monde où nous ne serions qu’un accident, où le chien qui passe, et jusqu’à la pierre des chemins, nous compléteraient, nous expliqueraient ; enfin, le grand tout, sans haut ni bas, ni sale ni propre, tel qu’il fonctionne... Bien sûr, c’est à la science que doivent s’adresser les romanciers et les poètes, elle est aujourd’hui l’unique source possible. Mais, voilà ! que lui prendre, comment marcher avec elle ? Tout de suite, je sens que je patauge... Ah ! si je savais, si je savais, quelle série de bouquins je lancerais à la tête de la foule !
Il se tut, lui aussi. L’hiver précédent, il avait publié son premier livre, une suite d’esquisses aimables, rapportées de Plassans, parmi lesquelles quelques notes plus rudes indiquaient seules le révolté, le passionné de vérité et de puissance. Et, depuis, il tâtonnait, il s’interrogeait, dans le tourment des idées, confuses encore, qui battaient son crâne. D’abord, épris des besognes géantes, il avait eu le projet d’une genèse de l’univers, en trois phases : la création, rétablie d’après la science ; l’histoire de l’humanité, arrivant à son heure jouer son rôle, dans la chaîne des êtres ; l’avenir, les êtres se succédant toujours, achevant de créer le monde, par le travail sans fin de la vie. Mais, il s’était refroidi devant les hypothèses trop hasardées de cette troisième phase ; et il cherchait un cadre plus resserré, plus humain, où il ferait tenir pourtant sa vaste ambition.
- Ah ! tout voir et tout peindre ! reprit Claude, après un long intervalle. Avoir des lieues de murailles à couvrir, décorer les gares, les halles, les mairies, tout ce qu’on bâtira, quand les architectes ne seront plus des crétins ! Et il ne faudra que des muscles et une tête solides, car ce ne sont pas les sujets qui manqueront... Hein ? la vie telle qu’elle passe dans les rues, la vie des pauvres et des riches, aux marchés, aux courses, sur les boulevards, au fond des ruelles populeuses ; et tous les métiers en branle ; et toutes les passions remises debout, sous le plein jour ; et les paysans, et les bêtes, et les campagnes !... On verra, on verra, si je ne suis pas une brute ! J’en ai des fourmillements dans les mains. Oui ! toute la vie moderne ! Des fresques hautes comme le Panthéon ! Une sacrée suite de toiles à faire éclater le Louvre !
Quelques tableaux dont s’inspire Zola
– Jean Auguste Dominique Ingres, La Grande Odalisque, 1814
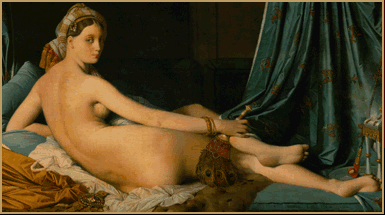
– Eugène Delacroix, La Mort de Sardanapale, 1827

– Gustave Courbet, Un Enterrement à Ornans, 1849

– Gustave Courbet, Paysans de Flagey, ou Le Retour de la foire, 1866

– Courbet, Le Sommeil, 1866
<doc497|center
– Paul Cézanne, Académie d’homme nu, 1862
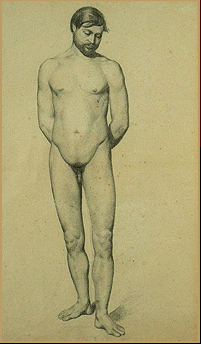
Zola, L’Œuvre (1886) : l’histoire du tableau Plein air, inspiré du Déjeuner sur l’herbe de Manet
Les trois étapes de la création d’un tableau de Claude intitulé Plein air : l’élaboration, l’achèvement et l’exposition au public.
– Texte 1
Un long silence se fit, tous deux regardaient, immobiles. C’était une toile de cinq mètres sur trois, entièrement couverte, mais dont quelques morceaux à peine se dégageaient de l’ébauche. Cette ébauche, jetée d’un coup, avait une violence superbe, une ardente vie de couleurs. Dans un trou de forêt, aux murs épais de verdure, tombait une ondée de soleil ; seule, à gauche, une allée sombre s’enfonçait, avec une tache de lumière, très loin. Là, sur l’herbe, au milieu des végétations de juin, une femme nue était couchée, un bras sous la tête, enflant la gorge ; et elle souriait, sans regard, les paupières closes, dans la pluie d’or qui la baignait. Au fond, deux autres petites femmes, une brune, une blonde, également nues, luttaient en riant, détachaient, parmi les verts des feuilles, deux adorables notes de chair. Et, comme au premier plan, le peintre avait eu besoin d’une opposition noire, il s’était bonnement satisfait, en y asseyant un monsieur, vêtu d’un simple veston de velours. Ce monsieur tournait le dos, on ne voyait de lui que sa main gauche, sur laquelle il s’appuyait, dans l’herbe. [...]
– Texte 2
Claude, qui se reculait maintenant jusqu’au mur, y demeura adossé, s’abandonnant. Alors, Sandoz, brisé par la pose, quitta le divan et alla se mettre près de lui. Puis, tous deux regardèrent, de nouveau muets. Le monsieur en veston de velours était ébauché entièrement ; la main, plus poussée que le reste, faisait dans l’herbe une note très intéressante, d’une jolie fraîcheur de ton ; et la tache sombre du dos s’enlevait avec tant de vigueur, que les petites silhouettes du fond, les deux femmes luttant au soleil, semblaient s’être éloignées, dans le frisson lumineux de la clairière ; tandis que la grande figure, la femme nue et couchée, à peine indiquée encore, flottait toujours, ainsi qu’une chair de songe, une Eve désirée naissant de la terre, avec son visage qui souriait, sans regards, les paupières closes.
- Décidément, comment appelles-tu ça ? demanda Sandoz.
- Plein air, répondit Claude d’une voix brève.
Mais ce titre parut bien technique à l’écrivain, qui, malgré lui, était parfois tenté d’introduire de la littérature dans la peinture.
- Plein air, ça ne dit rien.
- Ça n’a besoin de rien dire... Des femmes et un homme se reposent dans une forêt, au soleil. Est-ce que ça ne suffit pas ? Va, il y en a assez pour faire un chef-d’œuvre.
Il renversa la tête, il ajouta entre ses dents :
- Nom d’un chien, c’est encore noir ! J’ai ce sacré Delacroix dans l’œil. Et ça, tiens ! cette main-là, c’est du Courbet... Ah ! nous y trempons tous, dans la sauce romantique. Notre jeunesse y a trop barboté, nous en sommes barbouillés jusqu’au menton. Il nous faudra une fameuse lessive.
Sandoz haussa désespérément les épaules : lui aussi se lamentait d’être né au confluent d’Hugo et de Balzac. Cependant, Claude restait satisfait, dans l’excitation heureuse d’une bonne séance. Si son ami pouvait lui donner deux ou trois dimanches pareils, le bonhomme y serait, et carrément. Pour cette fois, il y en avait assez. Tous deux plaisantèrent, car d’habitude il tuait ses modèles, ne les lâchant qu’évanouis, morts de fatigue. [...]
– Texte 3
Son ami s’efforçait de l’emmener, mais il s’entêtait, il se rapprocha au contraire. Maintenant qu’il avait jugé son oeuvre, il écoutait et regardait la foule. L’explosion continuait, s’aggravait dans une gamme ascendante de fous rires. Dès la porte, il voyait se fendre les mâchoires des visiteurs, se rapetisser les yeux, s’élargir le visage ; et c’étaient des souffles tempétueux d’hommes gras, des grincements rouillés d’hommes maigres, dominés par les petites flûtes aiguës des femmes. En face, contre la cimaise, des jeunes gens se renversaient, comme si on leur avait chatouillé les côtes. Une dame venait de se laisser tomber sur une banquette, les genoux serrés, étouffant, tâchant de reprendre haleine dans son mouchoir. Le bruit de ce tableau si drôle devait se répandre, on se ruait des quatre coins du Salon, des bandes arrivaient, se poussaient, voulaient en être. « Où donc ? - Là-bas ! - Oh ! cette farce ! » Et les mots d’esprit pleuvaient plus drus qu’ailleurs, c’était le sujet surtout qui fouettait la gaieté : on ne comprenait pas, on trouvait ça insensé, d’une cocasserie à se rendre malade. « Voilà, la dame a trop chaud, tandis que le monsieur a mis sa veste de velours, de peur d’un rhume. - Mais non, elle est déjà bleue, le monsieur l’a retirée d’une mare, et il se repose à distance, en se bouchant le nez. - Pas poli, l’homme ! il pourrait nous montrer son autre figure. - Je vous dis que c’est un pensionnat de jeunes filles en promenade : regardez les deux qui jouent à saute-mouton. - Tiens ! un savonnage : les chairs sont bleues, les arbres sont bleus, pour sûr qu’il l’a passé au bleu, son tableau ! » Ceux qui ne riaient pas, entraient en fureur : ce bleuissement, cette notation nouvelle de la lumière, semblaient une insulte. Est-ce qu’on laisserait outrager l’art ? De vieux messieurs brandissaient des cannes. Un personnage grave s’en allait, vexé, en déclarant à sa femme qu’il n’aimait pas les mauvaises plaisanteries. Mais un autre, un petit homme méticuleux, ayant cherché dans le catalogue l’explication du tableau, pour l’instruction de sa demoiselle, et lisant à voix haute le titre : Plein air, ce fut autour de lui une reprise formidable, des cris, des huées. Le mot courait, on le répétait, on le commentait : Plein air, oh ! oui, Plein air, le ventre à l’air, tout en l’air, tra la la laire ! Cela tournait au scandale, la foule grossissait encore, les faces se congestionnaient dans la chaleur croissante, chacune avec la bouche ronde et bête des ignorants qui jugent de la peinture, exprimant à elles toutes la somme d’âneries, de réflexions saugrenues, de ricanements stupides et mauvais, que la vue d’une oeuvre originale peut tirer à l’imbécillité bourgeoise.
Et, à ce moment, comme dernier coup, Claude vit reparaître Dubuche, qui traînait les Margaillan. Dès qu’il arriva devant le tableau, l’architecte, embarrassé, pris d’une honte lâche, voulut presser le pas, emmener son monde, en affectant de n’avoir aperçu ni la toile ni ses amis. Mais déjà l’entrepreneur s’était planté sur ses courtes jambes, écarquillant les yeux, lui demandant très haut, de sa grosse voix rauque :
- Dites donc, quel est le sabot qui a fichu ça ?
Cette brutalité bonne enfant, ce cri d’un parvenu millionnaire qui résumait la moyenne de l’opinion redoubla l’hilarité ; et lui, flatté de son succès, les côtes chatouillées par l’étrangeté de cette peinture, partit à son tour, mais d’un rire tel, si démesuré, si ronflant, au fond de sa poitrine grasse, qu’il dominait tous les autres. C’était l’alléluia, l’éclat final des grandes orgues.
- Emmenez ma fille, dit la pâle Mme Margaillan à l’oreille de Dubuche.
Il se précipita, dégagea Régine, qui avait baissé les paupières ; et il déployait des muscles vigoureux comme s’il eût sauvé ce pauvre être d’un danger de mort. Puis, ayant quitté les Margaillan à la porte, après des poignées de main et des saluts d’homme du monde, il revint vers ses amis, il dit carrément à Sandoz, à Fagerolles et à Gagnière :
- Que voulez-vous ? ce n’est pas ma faute... Je l’avais prévenu que le public ne comprendrait pas. C’est cochon, oui, vous aurez beau dire, c’est cochon !
- Ils ont hué Delacroix, interrompit Sandoz, blanc de rage, les poings serrés. Ils ont hué Courbet ! Ah ! race ennemie, stupidité de bourreaux !
Zola, Edouard Manet, étude biographique et critique (1867)
Zola analyse ici Le Déjeuner sur l’herbe, tableau de Manet qui suscita des ricanements et des indignations lors qu’il fut exposé au Salon des Refusés en 1863.
Le Déjeuner sur l’herbe est la plus grande toile d’Edouard Manet, celle où il a réalisé le rêve que font tous les peintres : mettre des figures de grandeur naturelle dans un paysage. On sait avec quelle puissance il a vaincu cette difficulté. Il y a là quelques feuillages, quelques troncs d’arbres, et, au fond, une rivière dans laquelle se baigne une femme en chemise ; sur le premier plan, deux jeunes gens sont assis en face d’une seconde femme qui vient de sortir de l’eau et qui sèche sa peau nue au grand air. Cette femme nue a scandalisé le public, qui n’a vu qu’elle dans la toile. Bon Dieu ! quelle indécence : une femme sans le moindre voile entre deux hommes habillés ! Cela ne s’était jamais vu. Et cette croyance était une grossière erreur, car il y a au musée du Louvre plus de cinquante tableaux dans lesquels se trouvent mêlés des personnages habillés et des personnages nus. Mais personne ne va chercher à se scandaliser au musée du Louvre. La foule s’est bien gardée d’ailleurs de juger Le Déjeuner sur l’herbe comme doit être jugée une véritable œuvre d’art ; elle y a vu seulement des gens qui mangeaient sur l’herbe, au sortir du bain, et elle a cru que l’artiste avait mis une intention obscène et tapageuse dans la disposition du sujet, lorsque l’artiste avait simplement cherché à obtenir des oppositions vives et des masses franches. Les peintres, surtout Edouard Manet, qui est un peintre analyste, n’ont pas cette préoccupation du sujet qui tourmente la foule avant tout ; le sujet pour eux est un prétexte à peindre, tandis que pour la foule le sujet seul existe. Ainsi, assurément, la femme nue du Déjeuner sur l’herbe n’est là que pour fournir à l’artiste l’occasion de peindre un peu de chair. Ce qu’il faut voir dans le tableau, ce n’est pas un déjeuner sur l’herbe, c’est le paysage entier, avec ses vigueurs et ses finesses, avec ses premiers plans si larges, si solides, et ses fonds d’une délicatesse si légère ; c’est cette chair ferme, modelée à grands pans de lumière, ces étoffes souples et fortes, et surtout cette délicieuse silhouette de femme en chemise qui fait, dans le fond, une adorable tache blanche au milieu des feuilles vertes ; c’est enfin cet ensemble vaste, plein d’air, ce coin de la nature rendu avec une simplicité si juste, toute cette page admirable dans laquelle un artiste a mis les éléments particuliers et rares qui étaient en lui.
– Manet, Le Déjeuner sur l’herbe, 1863

Zola, La Faute de l’abbé Mouret (1875)
Abandonnée par Serge, Albine erre dans le Paradou avant de se donner la mort.
A cette heure, Albine, dans le Paradou, rôdait encore, traînant l’agonie muette d’une bête blessée. Elle ne pleurait plus. Elle avait un visage blanc, traversé au front d’un grand pli. Pourquoi donc souffrait-elle toute cette mort ? De quelle faute était-elle coupable, pour que, brusquement, le jardin ne lui tint plus les promesses qu’il lui faisait depuis l’enfance. Et elle s’interrogeait, allant devant elle, sans voir les allées où l’ombre coulait peu à peu. Pourtant, elle avait toujours obéi aux arbres. Elle ne se souvenait pas d’avoir cassé une fleur. Elle était restée la fille aimée des verdures, les écoutant avec soumission, s’abandonnant à elles, pleine de foi dans les bonheurs qu’elles lui réservaient. Lorsque, au dernier jour, le Paradou lui avait crié de se coucher sous l’arbre géant, elle s’était couchée, elle avait ouvert les bras, répétant la leçon soufflée par les herbes. Alors, si elle ne trouvait rien à se reprocher, c’était donc le jardin qui la trahissait, qui la torturait, pour la seule joie de la voir souffrir.
Elle s’arrêta, elle regarda autour d’elle. Les grandes masses sombres des feuillages gardaient un silence recueilli, les sentiers, où des murs noirs se bâtissaient, devenaient des impasses de ténèbres ; les nappes de gazon, au loin, endormaient les vents qui les effleuraient. Et elle tendit les mains désespérément, elle eut un cri de protestation. Cela ne pouvait finir ainsi. Mais sa voix s’étouffa sous les arbres silencieux. Trois fois, elle conjura le Paradou de répondre, sans qu’une explication lui vînt des hautes branches, sans qu’une seule feuille la prît en pitié. Puis, quand elle se fut remise à rôder, elle se sentit marcher dans la fatalité de l’hiver. Maintenant qu’elle ne questionnait plus la terre en créature révoltée, elle entendait une voix basse courant au ras du sol, la voix d’adieu des plantes, qui se souhaitaient une mort heureuse. Avoir bu le soleil de toute une saison, avoir vécu toujours en fleurs, s’être exhalé en un parfum continu, puis s’en aller au premier tourment, avec l’espoir de repousser quelque part, n’était-ce pas une vie assez longue, une vie bien remplie, que gâterait un entêtement à vivre davantage ? Ah ! comme on devait être bien, morte, ayant une nuit sans fin devant soi, pour songer à la courte journée vécue, pour en fixer éternellement les joies fugitives !
Elle s’arrêta de nouveau, mais elle ne protesta plus, au milieu du grand recueillement du Paradou. Elle croyait comprendre, à cette heure. Sans doute, le jardin lui ménageait la mort comme une jouissance suprême. C’était à la mort qu’il l’avait conduite d’une si tendre façon. Après l’amour, il n’y avait plus que la mort. Et jamais le jardin ne l’avait tant aimée ; elle s’était montrée ingrate en l’accusant, elle restait sa fille la plus chère. Les feuillages silencieux, les sentiers barrés de ténèbres, les pelouses où le vent s’assoupissait, ne se taisaient que pour l’inviter à la joie d’un long silence. Ils la voulaient avec eux, dans le repos du froid ; ils rêvaient de l’emporter, roulée parmi les feuilles sèches, les yeux glacés comme l’eau des sources, les membres raidis comme les branches nues, le sang dormant le sommeil de la sève. Elle vivrait leur existence jusqu’au bout, jusqu’à leur mort. Peut-être avaient-ils déjà résolu qu’à la saison prochaine elle serait un rosier du parterre, un saule blond des prairies, ou un jeune bouleau de la forêt. C’était la grande loi de la vie : elle allait mourir.
Alors, une dernière fois, elle reprit sa course à travers le jardin, en quête de la mort. Quelle plante odorante avait besoin de ses cheveux pour accroître le parfum de ses feuilles ? Quelle fleur lui demandait le don de sa peau de satin, la blancheur pure de ses bras, la laque tendre de sa gorge ? A quel arbuste malade devait-elle offrir son jeune sang ? Elle aurait voulu être utile aux herbes qui végétaient sur le bord des allées, se tuer là, pour qu’une verdure poussât d’elle, superbe, grasse, pleine d’oiseaux en mai et ardemment caressée du soleil. Mais le Paradou resta muet longtemps encore, ne se décidant pas à lui confier dans quel dernier baiser il l’emporterait. Elle dut retourner partout, refaire le pèlerinage de ses promenades. La nuit était presque entièrement tombée, et il lui semblait qu’elle entrait peu à peu dans la terre. Elle monta aux grandes roches, les interrogeant, leur demandant si c’était sur leurs lits de cailloux qu’il lui fallait expirer. Elle traversa la forêt, attendant, avec un désir qui ralentissait sa marche, que quelque chêne s’écroulât et l’ensevelît dans la majesté de sa chute. Elle longea les rivières des prairies, se penchant presque à chaque pas, regardant au fond des eaux si une couche ne lui était pas préparée, parmi les nénuphars. Nulle part, la mort ne l’appelait, ne lui tendait ses mains fraîches. Cependant, elle ne se trompait point. C’était bien le Paradou qui allait lui apprendre à mourir, comme il lui avait appris à aimer. Elle recommença à battre les buissons, plus affamée qu’aux matinées tièdes où elle cherchait l’amour. Et, tout d’un coup, au moment où elle arrivait au parterre, elle surprit la mort, dans les parfums du soir. Elle courut, elle eut un rire de volupté. Elle devait mourir avec les fleurs.
D’abord, elle courut au bois de roses. Là, dans la dernière lueur du crépuscule, elle fouilla les massifs, elle cueillit toutes les roses qui s’alanguissaient aux approches de l’hiver. Elle les cueillait à terre, sans se soucier des épines ; elle les cueillait devant elle, des deux mains ; elle les cueillait au-dessus d’elle, se haussant sur les pieds, ployant les arbustes. Une telle hâte la poussait, qu’elle cassait les branches, elle qui avait le respect des moindres brins d’herbe. Bientôt elle eut des roses plein les bras, un fardeau de roses sous lequel elle chancelait. Puis, elle rentra au pavillon, ayant dépouillé le bois, emportant jusqu’aux pétales tombés ; et quand elle eut laissé glisser sa charge de roses sur le carreau de la chambre au plafond bleu, elle redescendit dans le parterre.
Alors, elle chercha les violettes. Elle en faisait des bouquets énormes qu’elle serrait un à un contre sa poitrine. Ensuite, elle chercha les oeillets, coupant tout jusqu’aux boutons, liant des gerbes géantes d’œillets blancs, pareilles à des jattes de lait, des gerbes géantes d’œillets rouges, pareilles à des jattes de sang. Et elle chercha encore les quarantaines, les belles-de-nuit, les héliotropes, les lis ; elle prenait à poignée les dernières tiges épanouies des quarantaines, dont elle froissait sans pitié les ruches de satin ; elle dévastait les corbeilles de belles-de-nuit, ouvertes à peine à l’air du soir ; elle fauchait le champ des héliotropes, ramassant en tas sa moisson de fleurs ; elle mettait sous ses bras des paquets de lis, comme des paquets de roseaux. Lorsqu’elle fut de nouveau chargée, elle remonta au pavillon jeter, à côté des roses, les violettes, les oeillets, les quarantaines, les belles-de-nuit, les héliotropes, les lis. Et, sans reprendre haleine, elle redescendit.
Cette fois, elle se rendit à ce coin mélancolique qui était comme le cimetière du parterre. Un automne brûlant y avait mis une seconde poussée des fleurs du printemps. Elle s’acharna surtout sur des plates-bandes de tubéreuses et de jacinthes, à genoux au milieu des herbes, menant sa récolte avec des précautions d’avare. Les tubéreuses semblaient pour elle des fleurs précieuses, qui devaient distiller goutte à goutte de l’or, des richesses, des biens extraordinaires. Les jacinthes, toutes perlées de leurs grains fleuris, étaient comme des colliers dont chaque perle allait lui verser des joies ignorées aux hommes. Et, bien qu’elle disparût dans la brassée de jacinthes et de tubéreuses qu’elle avait coupée, elle ravagea plus loin un champ de pavots, elle trouva moyen de raser encore un champ de soucis. Par-dessus les tubéreuses, par-dessus les jacinthes, les soucis et les pavots s’entassèrent. Elle revint en courant se décharger dans la chambre au plafond bleu, veillant à ce que le vent ne lui volât pas un pistil. Elle redescendit.
Qu’allait-elle cueillir maintenant ? Elle avait moissonné le parterre entier. Quand elle se haussait sur les pieds, elle ne voyait plus, sous l’ombre encore grise, que le parterre mort, n’ayant plus les yeux tendres de ses roses, le rire rouge de ses oeillets, les cheveux parfumés de ses héliotropes. Pourtant, elle ne pouvait remonter les bras vides. Et elle s’attaqua aux herbes, aux verdures ; elle rampa, la poitrine contre le sol, cherchant dans une suprême étreinte de passion à emporter la terre elle-même. Ce fut la moisson des plantes odorantes, les citronnelles, les menthes, les verveines, dont elle emplissait sa jupe. Elle rencontra une bordure de baume et n’en laissa pas une feuille. Elle prit même deux grands fenouils, qu’elle jeta sur ses épaules, ainsi que deux arbres. Si elle avait pu, entre ses dents serrées, elle aurait emmené derrière elle toute la nappe verte du parterre. Puis, au seuil du pavillon, elle se tourna, elle jeta un dernier regard sur le Paradou. Il était noir ; la nuit, tombée complètement, lui avait jeté un drap noir sur la face. Et elle monta, pour ne plus redescendre.
La grande chambre, bientôt, fut parée. Elle avait posé une lampe allumée sur la console. Elle triait les fleurs amoncelées au milieu du carreau, elle en faisait de grosses touffes qu’elle distribuait à tous les coins. D’abord, derrière la lampe sur la console, elle mit les lis, une haute dentelle qui attendrissait la lumière de sa pureté blanche. Puis, elle porta des poignées d’œillets et de quarantaines sur le vieux canapé, dont l’étoffe peinte était déjà semée de bouquets rouges, fanés depuis cent ans ; et l’étoffe disparut, le canapé allongea contre le mur un massif de quarantaines hérissé d’œillets. Elle rangea alors les quatre fauteuils devant l’alcôve ; elle emplit le premier de soucis, le second de pavots, le troisième de belles-de-nuit, le quatrième d’héliotropes ; les fauteuils, noyés, ne montrant que des bouts de leurs bras, semblaient des bornes de fleurs. Enfin, elle songea au lit. Elle roula près du chevet une petite table, sur laquelle elle dressa un tas énorme de violettes. Et, à larges brassées, elle couvrit entièrement le lit de toutes les jacinthes et de toutes les tubéreuses qu’elle avait apportées ; la couche était si épaisse, qu’elle débordait sur le devant, aux pieds, à la tête, dans la ruelle, laissant couler des traînées de grappes. Le lit n’était plus qu’une grande floraison. Cependant, les roses restaient. Elle les jeta au hasard, un peu partout ; elle ne regardait même pas où elles tombaient ; la console, le canapé, les fauteuils, en reçurent ; un coin du lit en fut inondé. Pendant quelques minutes, il plut des roses, à grosses touffes, une averse de fleurs lourdes comme des gouttes d’orage, qui faisaient des mares dans les trous du carreau. Mais le tas ne diminuant guère, elle finit par en tresser des guirlandes qu’elle pendit aux murs. Les Amours de plâtre qui polissonnaient au-dessus de l’alcôve eurent des guirlandes de roses au cou, aux bras, autour des reins ; leurs ventres nus, leurs culs nus furent tout habillés de roses. Le plafond bleu, les panneaux ovales encadrés de nœuds de ruban couleur chair, les peintures érotiques mangées par le temps, se trouvèrent tendus d’un manteau de roses, d’une draperie de roses. La grande chambre était parée. Maintenant, elle pouvait y mourir. Un instant, elle resta debout, regardant autour d’elle. Elle songeait, elle cherchait si la mort était là. Et elle ramassa les verdures odorantes, les citronnelles, les menthes, les verveines, les baumes, les fenouils ; elle les tordit, les plia, en fabriqua des tampons, à l’aide desquels elle alla boucher les moindres fentes, les moindres trous de la porte et des fenêtres. Puis, elle tira les rideaux de calicot blanc, cousus à gros points. Et, muette, sans un soupir, elle se coucha sur le lit, sur la floraison des jacinthes et des tubéreuses.
Là, ce fut une volupté dernière. Les yeux grands ouverts, elle souriait à la chambre. Comme elle avait aimé, dans cette chambre ! Comme elle y mourait heureuse ! A cette heure, rien d’impur ne lui venait plus des Amours de plâtre, rien de troublant ne descendait plus des peintures, où des membres de femme se vautraient. Il n’y avait, sous le plafond bleu, que le parfum étouffant des fleurs. Et il semblait que ce parfum ne fût autre que l’odeur d’amour ancien dont l’alcôve était toujours restée tiède, une odeur grandie, centuplée, devenue si forte, qu’elle soufflait l’asphyxie. Peut-être était-ce l’haleine de la dame morte là, il y avait un siècle. Elle se trouvait ravie à son tour, dans cette haleine. Ne bougeant point, les mains jointes sur son cœur, elle continuait à sourire, elle écoutait les parfums qui chuchotaient dans sa tête bourdonnante. Ils lui jouaient une musique étrange de senteurs qui l’endormait lentement, très doucement. D’abord, c’était un prélude gai, enfantin : ses mains, qui avaient tordu les verdures odorantes, exhalaient l’âpreté des herbes foulées, lui contaient ses courses de gamine au milieu des sauvageries du Paradou. Ensuite, un chant de flûte se faisait entendre, de petites notes musquées qui s’égrenaient du tas de violettes posé sur la table, près du chevet ; et cette flûte, brodant sa mélodie sur l’haleine calme, l’accompagnement régulier des lis de la console, chantait les premiers charmes de son amour, le premier aveu, le premier baiser sous la futaie. Mais elle suffoquait davantage, la passion arrivait avec l’éclat brusque des oeillets, à l’odeur poivrée, dont la voix de cuivre dominait un moment toutes les autres. Elle croyait qu’elle allait agoniser dans la phrase maladive des soucis et des pavots, qui lui rappelait les tourments de ses désirs. Et, brusquement, tout s’apaisait, elle respirait plus librement, elle glissait à une douceur plus grande, bercée par une gamme descendante des quarantaines, se ralentissant, se noyant, jusqu’à un cantique adorable des héliotropes, dont les haleines de vanille disaient l’approche des noces. Les belles-de-nuit piquaient çà et là un trille discret. Puis, il y eut un silence. Les roses, languissamment, firent leur entrée. Du plafond coulèrent des voix, un chœur lointain. C’était un ensemble large, qu’elle écouta au début avec un léger frisson. Le chœur s’enfla, elle fut bientôt tout vibrante des sonorités prodigieuses qui éclataient autour d’elle. Les noces étaient venues, les fanfares des roses annonçaient l’instant redoutable. Elle, les mains de plus en plus serrées contre son cœur, pâmée, mourante, haletait. Elle ouvrait la bouche, cherchant le baiser qui devait l’étouffer, quand les jacinthes et les tubéreuses fumèrent, l’enveloppèrent d’un dernier soupir, si profond, qu’il couvrit le chœur des roses. Albine était morte dans le hoquet suprême des fleurs.











