Etude d’un mouvement littéraire et artistique :
les ressources TICE du site Louvre-edu
La représentation rationnelle de l’univers aboutit à une cristallisation de la vérité,
figée dans les formes imposées par les structures de la science. (...)
Le romantisme dénonce cette aliénation ; la conscience, pour se découvrir elle-même,
doit se déprendre de l’univers du discours objectif dont elle est captive,
et chercher en elle-même le principe de l’authentique connaissance de soi et du monde.Georges Gusdorf, L’homme romantique, 1984, p. 78
Introduction
Aborder le romantisme par les TICE : pour une bonne utilisation des TICE
Il arrive que les élèves soient parfois plus avancés en informatique que leurs professeurs : le danger que l’on perçoit ici est la dispersion suivie de noyade et sauvée par un hâtif copier-coller à travers cédéroms et ressources internet. En l’occurrence, reproduire tout ou partie des divers articles Romantisme (qu’il s’agisse d’Encarta ou de l’Encyclopedia Universalis) ne peut conduire qu’à reproduire les clichés sur les « écoles », à ne pas vraiment lire les textes et à empêcher la réflexion et l’assimilation approfondie des connaissances.
Ces ressources sont pourtant considérables : ouverture facile aux autres arts (peinture en particulier, mais aussi sculpture et musique), accès à des textes pas forcément connus et pourtant éclairants, possibilité de comparer sur pièces un texte et un tableau avec des instruments d’analyse que ne permettaient pas le livre et la visite rapide et unique d’un musée...
Pour exploiter pleinement ces ressources, et développer chez l’élève à la fois la curiosité et l’esprit critique, il faut que le professeur balise au départ les parcours et maintienne une exigence sans tuer l’initiative et le goût en cours de route.
On pourra se reporter aux travaux :
– de Danielle Girard sur le Romantisme, et en particulier le travail mené sur Delacroix avec une classe de seconde.
– des professeurs du lycée Claude Monet au Havre qui proposent plusieurs expérimentations pédagogiques à partir du site du Louvre. Voir en particulier le travail mené sur « la peinture romantique » et sur « Balzac et la peinture ».
L’image de la femme : un axe de lecture pour aborder le romantisme
L’image de la femme à travers le préromantisme et le romantisme permet à la fois de repérer une mode et un cliché (la femme angélique, de préférence soeur et/ou vierge et/ou morte, rompant avec le paradigme de la femme manoeuvrée ou manoeuvrière d’un XVIIIe siècle libertin) et de nuancer cette image pour faire découvrir aux élèves la diversité du romantisme et son aspiration profonde : libérer l’être humain de ses limites.
Après avoir donné aux élèves les repères nécessaires d’histoire littéraire et culturelle, on pourra proposer aux élèves un groupement de textes et un ensemble d’oeuvres picturales.
– un premier travail consistera à trouver avec eux en classe entière des constantes et des oppositions.
– on procèdera à une répartition du travail sous forme de dossiers, avec la possibilité donnée aux élèves de consulter au CDI ou en salle informatique un certain nombre de ressources :
- Le site Internet du Louvre : http://www.louvre.edu
- Robert électronique, Encyclopédie Universalis,
- Dictionnaire des Oeuvres Littéraires,
- Cédéroms Chateaubriand et Balzac d’Acamedia, cédérom Le XIXe siècle de Victor Hugo,
- Ressources internet de la BNF, particulièrement les expositions virtuelles consacrées à Victor Hugo, l’homme océan et à Berlioz, la voix du romantisme
- Ressources internet de Gallica, et en particulier les pages consacrées au mouvement romantique
– on guidera un certain nombre d’élèves peu habitués à tirer profit de ces outils au cours de séances d’aide individualisée en salle informatique ou au CDI (il existe des établissements où une petite salle informatique est attenante au CDI).
– on rassemblera les conclusions en classe entière.
La femme évanescente ou victime
Pistes d’étude : la virginité, la dépendance, l’idéalisation, la mort
La mort d’Atala
Le roman : Chateaubriand, La mort d’Atala comparée avec le tableau de Girodet.
– Chateaubriand : La mort d’Atala
– Chateaubriand : Les funérailles d’Atala

source : bibliothèque Louvre.edu

source : bibliothèque Louvre.edu
Girodet : entre romantisme et néoclassicisme
Entré fort jeune, en 1785, dans l’atelier de David, il en est un des élèves les plus brillants et remporte le grand prix de Rome de peinture d’histoire en 1789. Son séjour à Rome est caractérisé, au contact avec la peinture italienne, par une relative rupture avec l’art de David. S’intéressant à Léonard de Vinci et au Corrège, passionné par le modelé des chairs, il peint l’étonnant Sommeil d’Endymion (musée du Louvre), qui est un des premiers tableaux nettement romantiques. Portraitiste, il immortalise Chateaubriand en 1809 (musée de
Saint-Malo) et il s’intéresse également au genre du paysage, qu’il pratique et collectionne durant toute sa carrière. Mais ses œuvres les plus importantes, Ossian (château de Malmaison), Le Déluge ou Les Funérailles d’Atala (musée du Louvre) sont peintes durant l’Empire.
Curieusement le romantisme poétique des œuvres de cette période s’estompe sous la Restauration et son art revient alors à un néoclassicisme plus conventionnel qu’il distille dans l’enseignement de son atelier très renommé.
Le personnage de Pauline
Le roman : Balzac, La Peau de chagrin. Epilogue : le personnage de Pauline. Analyse à mener à partir du cédérom « Balzac ».
– Balzac : La Peau de Chagrin
La jeune orpheline
La poésie lyrique : Lamartine : « Pensée des morts » en relation avec la « Jeune orpheline au cimetière de Delacroix » (1824)
– Alphonse de Lamartine, Harmonies poétiques et religieuses (1830). Pensée des morts

source : bibliothèque Louvre.edu

source : bibliothèque Louvre.edu
Le visage dit l’effroi et le manque :
« Pourquoi m’as-tu abandonné ? »
La nonne
La poésie narrative : Hugo : « La Légende de la nonne »
– Hugo, Odes et Ballades, La Vierge séduite (1828)
La femme sacrifiée au théâtre
Le théâtre : le personnage de Rosette dans On ne badine pas avec l’amour (Acte III, sc. 7 et 8) ou de Doña Sol dans Hernani (Acte V, sc. 6)
L’obsession de la mort
La lettre : Eugénie de Guérin : Journal (1834) : l’obsession de la mort
– Eugénie de Guérin, La mort de la jeune fille
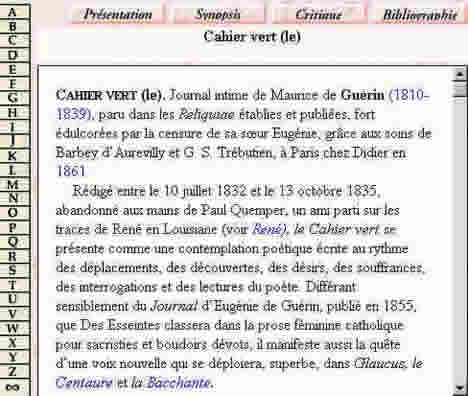
La femme au coeur des combats
Pistes d’étude : la passion, la révolution, le combat féministe
La liberté guidant le peuple (1830)
Textes ou sujet de dossiers proposés : La poésie : Auguste Barbier : Iambes comparé au tableau de Delacroix : « La Liberté guidant le peuple » (1830)
– Auguste Barbier, La Femme-Liberté

source : bibliothèque Louvre.edu

source : bibliothèque Louvre.edu
La femme engagée au théâtre
Le théâtre : Hugo : les personnages de Marion Delorme (acte V, sc. 6), de Jane dans Marie Tudor (3e partie, 2e journée, sc. 2 et dernière).
Un roman engagé : Indiana de George Sand
Un roman « engagé » : George Sand :Indiana
– George Sand, Indiana
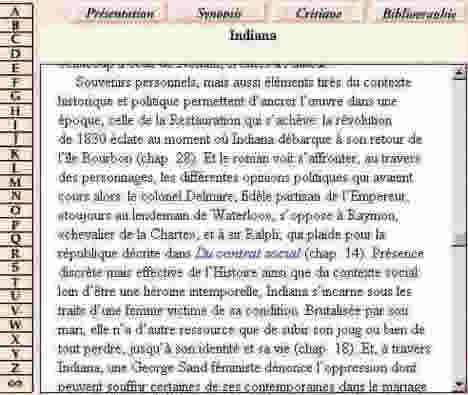


– Voir le site du film « Les Enfants du Siècle » de Diane Kurys
Retournement de situation picturale : On pourra montrer aux élèves, en comparant l’affiche du film avec le tableau de Delacroix,comment le jeu des mains transfigure le rapport conventionnel des sexes. Les corps retournés : dans le tableau de Delacroix, à l’inverse de l’affiche du film, la femme est soumise aux pieds de son seigneur et maître.
Conclusion et Ouverture
Quand on se sera assuré que les élèves auront bien situé ce mouvement dans l’histoire littéraire, on pourra leur montrer la persistance de certaines de ces images de la femme, par exemple dans le personnage de Miette, de La Fortune des Rougon de Zola, qui combine les images de la jeune morte et de la Liberté guidant le Peuple, ou de la soeur morte à travers les Poésies de Mallarmé.
Autrement dit, on montrera que le romantisme est encore présent, même dans ce qu’on a appelé naturalisme et symbolisme.
Extraits des textes étudiés
Chateaubriand, La mort d’Atala
Ici la voix d’Atala s’éteignit ; les ombres de la mort se répandirent autour de ses yeux et de sa bouche ; ses doigts errants cherchaient à toucher quelque chose ; elle conversait tout bas avec des esprits invisibles. Bientôt, faisant un effort, elle essaya, mais en vain, de détacher de son cou le petit crucifix ; elle me pria de le dénouer moi-même, et elle me dit :
« Quand je te parlai pour la première fois, tu vis cette croix briller à la lueur du feu sur mon sein ; c’est le seul bien que possède Atala. Lopez, ton père et le mien, l’envoya à ma mère peu de jours après ma naissance. Reçois donc de moi cet héritage, ô mon frère, conserve-le en mémoire de mes malheurs. Tu auras recours à ce Dieu des infortunés dans les chagrins de ta vie. Chactas, j’ai une dernière prière à te faire. Ami, notre union aurait été courte sur la terre, mais il est après cette vie une plus longue vie. Qu’il serait affreux d’être séparé de toi pour jamais ! Je ne fais que te devancer aujourd’hui, et je te vais attendre dans l’empire céleste. Si tu m’as aimée, fais-toi instruire dans la religion chrétienne, qui préparera notre réunion. Elle fait sous tes yeux un grand miracle, cette religion, puisqu’elle me rend capable de te quitter, sans mourir dans les angoisses du désespoir. Cependant, Chactas, je ne veux de toi qu’une simple promesse ; je sais trop ce qu’il en coûte, pour te demander un serment. Peut-être ce vœu te séparerait-il de quelque femme plus heureuse que moi... O ma mère ! pardonne à ta fille. O Vierge ! retenez votre courroux. Je retombe dans mes faiblesses, et je te dérobe, ô mon Dieu ! des pensées qui ne devraient être que pour toi ».
Navré de douleur, je promis à Atala d’embrasser un jour la religion chrétienne. A ce spectacle, le Solitaire, se levant d’un air inspiré et étendant les bras vers la voûte de la grotte : « Il est temps, s’écria-t-il, il est temps d’appeler Dieu ici ! »
A peine a-t-il prononcé ces mots, qu’une force surnaturelle me contraint de tomber à genoux et m’incline la tête au pied du lit d’Atala. Le prêtre ouvre un lieu secret où était enfermée une urne d’or couverte d’un voile de soie ; il se prosterne et adore profondément. La grotte parut soudain illuminée ; on entendit dans les airs les paroles des anges et les frémissements des harpes célestes ; et lorsque le Solitaire tira le vase sacré de son tabernacle, je crus voir Dieu lui-même sortir du flanc de la montagne.
Le prêtre ouvrit le calice ; il prit entre ses deux doigts une hostie blanche comme la neige, et s’approcha d’Atala en prononçant des mots mystérieux. Cette sainte avait les yeux levés au ciel, en extase. Toutes ses douleurs parurent suspendues, toute sa vie se rassembla sur sa bouche ; ses lèvres s’entr’ouvrirent, et vinrent avec respect chercher le Dieu caché sous le pain mystique. Ensuite le divin vieillard trempe un peu de coton dans une huile consacrée ; il en frotte les tempes d’Atala, il regarde un moment la fille mourante, et tout à coup ces fortes paroles lui échappent :
« Partez, âme chrétienne, allez rejoindre votre Créateur ! » Relevant alors ma tête abattue, je m’écriai en regardant le vase où était l’huile sainte : « Mon père, ce remède rendra-t-il la vie à Atala ? - Oui, mon fils, dit le vieillard en tombant dans mes bras, la vie éternelle ! » Atala venait d’expirer.
Chateaubriand. Les funérailles d’Atala
Nous convînmes que nous partirions le lendemain au lever du soleil pour enterrer Atala sous l’arche du pont naturel, à l’entrée des Bocages de la mort. Il fut aussi résolu que nous passerions la nuit en prière auprès du corps de cette sainte.
Vers le soir, nous transportâmes ses précieux restes à une ouverture de la grotte qui donnait vers le Nord. L’ermite les avait roulés dans une pièce de lin d’Europe, filé par sa mère : c’était le seul bien qui lui restât de sa patrie, et depuis longtemps il le destinait à son propre tombeau. Atala était couchée sur un gazon de sensitives des montagnes ; ses pieds, sa tête, ses épaules et une partie de son sein étaient découverts. On voyait dans ses cheveux une fleur de magnolia fanée... Ses lèvres, comme un bouton de rose cueilli depuis deux matins, semblaient languir et sourire. Dans ses joues d’une blancheur éclatante, on distinguait quelques veines bleues. Ses beaux yeux étaient fermés, ses pieds modestes étaient joints, et ses mains d’albâtre pressaient sur son cœur un crucifix d’ébène ; le scapulaire de ses vœux était passé à son cou. Elle paraissait enchantée par l’Ange de la mélancolie, et par le double sommeil de l’innocence et de la tombe. Je n’ai rien vu de plus céleste. Quiconque eût ignoré que cette jeune fille avait joui de la lumière, aurait pu la prendre pour la statue de la Virginité endormie.
Le religieux ne cessa de prier toute la nuit. J’étais assis en silence au chevet du lit funèbre de mon Atala. Que de fois, durant son sommeil, j’avais supporté sur mes genoux cette tête charmante ! Que de fois je m’étais penché sur elle, pour entendre et pour respirer son souffle ! Mais à présent aucun bruit ne sortait de ce sein immobile, et c’était en vain que j’attendais le réveil de la beauté !
La lune prêta son pâle flambeau à cette veillée funèbre. Elle se leva au milieu de la nuit, comme une blanche vestale qui vient pleurer sur le cercueil d’une compagne. Bientôt elle répandit dans les bois ce grand secret de mélancolie, qu’elle aime à raconter aux vieux chênes et aux rivages antiques des mers. De temps en temps, le religieux plongeait un rameau fleuri dans une eau consacrée, puis secouant la branche humide, il parfumait la nuit des baumes du ciel. Parfois il répétait sur un air antique quelques vers d’un vieux poète nommé Job ; il disait :
« J’ai passé comme une fleur : j’ai séché comme l’herbe des champs.
Pourquoi la lumière a-t-elle été donnée à un misérable, et la vie à ceux qui sont dans l’amertume du cœur ? »
Ainsi chantait l’ancien des hommes. Sa voix grave et un peu cadencée allait roulant dans le silence des déserts. Le nom de Dieu et du tombeau sortait de tous les échos, de tous les torrents, de toutes les forêts. Les roucoulements de la colombe de Virginie, la chute d’un torrent dans la montagne, les tintements de la cloche qui appelait les voyageurs, se mêlaient à ces chants funèbres, et l’on croyait entendre dans les Bocages de la mort le chœur lointain des décédés, qui répondait à la voix du solitaire.
Cependant une barre d’or se forma dans l’orient. Les éperviers criaient sur les rochers et les martres rentraient dans le creux des ormes : c’était le signal du convoi d’Atala. Je chargeai le corps sur mes épaules : l’ermite marchait devant moi, une bêche à la main. Nous commençâmes à descendre de rochers en rochers : la vieillesse et la mort ralentissaient également nos pas. A la vue du chien qui nous avait trouvés dans la forêt, et qui maintenant, bondissant de joie, nous traçait une autre route, je me mis à fondre en larmes. Souvent la longue chevelure d’Atala, jouet des brises matinales, étendait son voile d’or sur mes yeux ; souvent, pliant sous le fardeau, j’étais obligé de le déposer sur la mousse et de m’asseoir auprès, pour reprendre des forces. Enfin, nous arrivâmes au lieu marqué par ma douleur ; nous descendîmes sous l’arche du pont. O mon fils ! Il eût fallu voir un jeune sauvage et un vieil ermite, à genoux l’un vis-à-vis de l’autre dans un désert, creusant avec leurs mains un tombeau pour une pauvre fille dont le corps était étendu près de là, dans la ravine desséchée d’un torrent !
Quand notre ouvrage fut achevé, nous transportâmes la beauté dans son lit d’argile. Hélas ! j’avais espéré de préparer une autre couche pour elle ! Prenant alors un peu de poussière dans ma main, et gardant un silence effroyable, j’attachai pour la dernière fois mes yeux sur le visage d’Atala. Ensuite je répandis la terre du sommeil sur un front de dix-huit printemps ; je vis graduellement disparaître les traits de ma sœur, et ses grâces se cacher sous le rideau de l’éternité ; son sein surmonta quelque temps le sol noirci, comme un lis blanc s’élève du milieu d’une sombre argile : « Lopez, m’écriai-je alors, vois ton fils inhumer ta fille ! » et j’achevai de couvrir Atala de la terre du sommeil.
Balzac. La Peau de Chagrin (1831)
Dans sa mansarde, Raphaël fait la connaissance de Pauline, la fille de sa logeuse, mais voici ce qu’il dit d’elle :
J’admirais cette charmante fille comme un tableau, comme le portrait d’une maîtresse morte. Enfin, c’était mon enfant, ma statue.
A la dernière page de l’Epilogue, après la mort de Raphaël, un dialogue narrateur-narrataire donne
trois images possibles du sort de Pauline
Et que devint Pauline ?
- Ah ! Pauline, bien. Etes-vous quelquefois resté par une douce soirée d’hiver devant votre foyer domestique, voluptueusement livré à des souvenirs d’amour ou de jeunesse en contemplant les rayures produites par le feu sur un morceau de chêne ? Ici la combustion dessine les cases rouges d’un damier, là elle miroite des velours ; de petites flammes bleues courent, bondissent et jouent sur le fond ardent du brasier. Vient un peintre inconnu qui se sert de cette flamme ; par un artifice unique, il trace au sein de ces flamboyantes teintes violettes ou empourprées une figure supernaturelle et d’une délicatesse inouïe, phénomène fugitif que le hasard ne recommencera jamais : c’est une femme aux cheveux emportés par le vent, et dont le profil respire une passion délicieuse : du feu dans le feu ! elle sourit, elle expire, vous ne la reverrez plus. Adieu fleur de la flamme, adieu principe incomplet, inattendu, venu trop tôt ou trop tard pour être quelque beau diamant.
- Mais Pauline ?
- Vous n’y êtes pas ? je recommence. Place ! place ! Elle arrive, la voici la reine des illusions, la femme qui passe comme un baiser, la femme vive comme un éclair, comme lui jaillie brûlante du ciel, l’être incréé, tout esprit, tout amour. Elle a revêtu je ne sais quel corps de flamme, ou pour elle la flamme s’est un moment animée ! Les lignes de ses formes sont d’une pureté qui vous dit qu’elle vient du ciel. Ne resplendit-elle pas comme un ange ? n’entendez-vous pas le frémissement aérien de ses ailes ? Plus légère que l’oiseau, elle s’abat près de vous et ses terribles yeux fascinent ; sa douce, mais puissante haleine attire vos lèvres par une force magique ; elle fuit et vous entraîne, vous ne sentez plus la terre. Vous tressaillez de tous vos nerfs, vous êtes tout désir, tout souffrance. O bonheur sans nom ! vous avez touché les lèvres de cette femme ; mais tout à coup une atroce douleur vous réveille. Ha ! ha ! votre tête a porté sur l’angle du lit, vous en avez embrassé l’acajou brun, les dorures froides, quelque bronze, un amour en cuivre.
- Mais, monsieur, Pauline !
- Encore ! Ecoutez. Par une belle matinée, en partant de Tours, un jeune homme embarqué sur la Ville d’Angers tenait dans sa main la main d’une jolie femme. Unis ainsi, tous deux admirèrent longtemps, au-dessus des larges eaux de la Loire, une blanche figure, artificiellement éclose au sein du brouillard comme un fruit des eaux et du soleil, ou comme un caprice des nuées et de l’air. Tour à tour ondine ou sylphide, cette fluide créature voltigeait dans les airs comme un mot vainement cherché qui court dans la mémoire sans se laisser saisir ; elle se promenait entre les îles, elle agitait sa tête à travers les hauts peupliers ; puis devenue gigantesque elle faisait ou resplendir les mille plies de sa robe, ou briller l’auréole décrite par le soleil autour de son visage ; elle planait sur les hameaux, sur les collines, et semblait défendre au bateau à vapeur de passer devant le château d’Ussé. Vous eussiez dit le fantôme de la Dame des Belles Cousines qui voulait protéger son pays contre les invasions modernes.
- Bien, je comprends, ainsi de Pauline. Mais Foedora ?
- Oh ! Foedora, vous la rencontrerez. Elle était hier aux Bouffons, elle ira ce soir à l’Opéra, elle est partout, c’est, si vous voulez, la Société.
Alphonse de Lamartine, Harmonies poétiques et religieuses (1830). Pensée des morts
| {{{***version originale}}} | {{{***version de Brassens}}} |
| Voilà les feuilles sans sève Qui tombent sur le gazon, Voilà le vent qui s'élève Et gémit dans le vallon, Voilà l'errante hirondelle . Qui rase du bout de l'aile : L'eau dormante des marais, Voilà l'enfant des chaumières Qui glane sur les bruyères Le bois tombé des forêts. |
Voilà les feuilles sans sève Qui tombent sur le gazon, Voilà le vent qui s'élève Et gémit dans le vallon, Voilà l'errante hirondelle Qui rase du bout de l'aile L'eau dormante des marais, Voila l'enfant des chaumières Qui glâne sur les bruyères Le bois tombé des forêts. |
| L'onde n'a plus le murmure , Dont elle enchantait les bois ; Sous des rameaux sans verdure. Les oiseaux n'ont plus de voix ; Le soir est près de l'aurore, L'astre à peine vient d'éclore Qu'il va terminer son tour, Il jette par intervalle Une heure de clarté pâle Qu'on appelle encore un jour. |
|
| L'aube n'a plus de zéphire Sous ses nuages dorés, La pourpre du soir expire Sur les flots décolorés, La mer solitaire et vide N'est plus qu'un désert aride Où l'oeil cherche en vain l'esquif, Et sur la grève plus sourde La vague orageuse et lourde N'a qu'un murmure plaintif. |
|
| La brebis sur les collines Ne trouve plus le gazon, Son agneau laisse aux épines Les débris de sa toison, La flûte aux accords champêtres Ne réjouit plus les hêtres Des airs de joie ou d'amour, Toute herbe aux champs est glanée : Ainsi finit une année, Ainsi finissent nos jours ! |
|
| C'est la saison où tout tombe Aux coups redoublés des vents ; Un vent qui vient de la tombe Moissonne aussi les vivants : Ils tombent alors par mille, Comme la plume inutile Que l'aigle abandonne aux airs, Lorsque des plumes nouvelles Viennent réchauffer ses ailes A l'approche des hivers. |
C'est la saison ou tout tombe Aux coups redoublés des vents ; Un vent qui vient de la tombe Moissonne aussi les vivants ; Ils tombent alors par mille, Comme la plume inutile Que l'aigle abandonne aux airs, Lorsque des plumes nouvelles Viennent réchauffer ses ailes A l'approche des hivers. |
| C'est alors que ma paupière Vous vit pâlir et mourir, Tendres fruits qu'à la lumière Dieu n'a pas laissé mûrir ! Quoique jeune sur la terre, Je suis déjà solitaire Parmi ceux de ma saison, Et quand je dis en moi-même : Où sont ceux que ton coeur aime ? Je regarde le gazon. |
C'est alors que ma paupière Vous vit pâlir et mourir, Tendres fruits qu'à la lumière Dieu n'a pas laissé mûrir ! Quoique jeune sur la terre, Je suis déjà solitaire Parmi ceux de ma saison, Et quand je dis en moi-même : Où sont ceux que ton coeur aime ? Je regarde le gazon. |
| Leur tombe est sur la colline, Mon pied la sait ; la voilà ! Mais leur essence divine, Mais eux, Seigneur, sont-ils là ? Jusqu'à l'indien rivage Le ramier porte un message Qu'il rapporte à nos climats ; La voile passe et repasse, Mais de son étroit espace Leur âme ne revient pas. |
|
| Ah ! quand les vents de l'automne Sifflent dans les rameaux morts, Quand le brin d'herbe frissonne, Quand le pin rend ses accords, Quand la cloche des ténèbres Balance ses glas funèbres, La nuit, à travers les bois, A chaque vent qui s'élève, A chaque flot sur la grève, Je dis : N'es-tu pas leur voix? |
|
| Du moins si leur voix si pure Est trop vague pour nos sens, Leur âme en secret murmure De plus intimes accents ; Au fond des coeurs qui sommeillent, Leurs souvenirs qui s'éveillent Se pressent de tous côtés, Comme d'arides feuillages Que rapportent les orages Au tronc qui les a portés ! |
|
| C'est une mère ravie A ses enfants dispersés, Qui leur tend de l'autre vie Ces bras qui les ont bercés ; Des baisers sont sur sa bouche, Sur ce sein qui fut leur couche Son coeur les rappelle à soi ; Des pleurs voilent son sourire, Et son regard semble dire : Vous aime-t-on comme moi ? |
|
| C'est une jeune fiancée Qui, le front ceint du bandeau, N'emporta qu'une pensée De sa jeunesse au tombeau ; Triste, hélas ! dans le ciel même, Pour revoir celui qu'elle aime Elle revient sur ses pas, Et lui dit : Ma tombe est verte ! Sur cette terre déserte Qu'attends-tu ? Je n'y suis pas ! |
C'est un ami de l'enfance, Qu'aux jours sombres du malheur Nous prêta la providence Pour appuyer notre coeur ; Il n'est plus : notre âme est veuve, Il nous suit dans notre épreuve Et nous dit avec pitié : Ami si ton âme et pleine, De ta joie ou de ta peine Qui portera la moitié ? |
| C'est un ami de l'enfance, Qu'aux jours sombres du malheur Nous prêta la Providence Pour appuyer notre cœur ; Il n'est plus ; notre âme est veuve, Il nous suit dans notre épreuve Et nous dit avec pitié : Ami, si ton âme est pleine, De ta joie ou de ta peine Qui portera la moitié ? |
C'est une jeune fiancée Qui, le front ceint du bandeau N'emporta qu'une pensée De sa jeunesse au tombeau ; Triste, hélas ! Dans le ciel même, Pour revoir celui qu'elle aime Elle revient sur ses pas, Et lui dit : Ma tombe est verte ! Sur cette terre déserte Qu'attends-tu ? je n'y suis pas ! |
| C'est l'ombre pâle d'un père Qui mourut en nous nommant ; C'est une soeur, c'est un frère, Qui nous devance un moment ; Sous notre heureuse demeure, Avec celui qui les pleure, Hélas ! ils dormaient hier ! Et notre coeur doute encore, Que le ver déjà dévore Cette chair de notre chair ! |
C'est l'ombre pâle d'un père Qui mourut en nous nommant ; C'est une soeur, c'est un frère, Qui nous devance un moment ; (...) |
| L'enfant dont la mort cruelle Vient de vider le berceau, Qui tomba de la mamelle Au lit glacé du tombeau ; Tous ceux enfin dont la vie Un jour ou l'autre ravie, Emporte une part de nous, Murmurent sous la poussière : Vous qui voyez la lumière, Vous souvenez-vous de nous ? |
Tous ceux enfin dont la vie |
Ah ! vous pleurer est le bonheur
suprême |
|
| Ils furent ce que nous sommes, Poussière, jouet du vent ! Fragiles comme des hommes, Faibles comme le néant ! Si leurs pieds souvent glissèrent, Si leurs lèvres transgressèrent Quelque lettre de ta loi, Ô Père! ô juge suprême ! Ah ! ne les vois pas eux-mêmes, Ne regarde en eux que toi ! |
|
| Si tu scrutes la poussière, Elle s'enfuit à ta voix ! Si tu touches la lumière, Elle ternira tes doigts ! Si ton oeil divin les sonde, Les colonnes de ce monde Et des cieux chancelleront : Si tu dis à l'innocence : Monte et plaide en ma présence ! Tes vertus se voileront. |
|
| Mais toi, Seigneur, tu possèdes Ta propre immortalité ! Tout le bonheur que tu cèdes Accroît ta félicité ! Tu dis au soleil d'éclore, Et le jour ruisselle encore ! Tu dis au temps d'enfanter, Et l'éternité docile, Jetant les siècles par mille, Les répand sans les compter ! |
|
| Les mondes que tu répares Devant toi vont rajeunir, Et jamais tu ne sépares Le passé de l'avenir ; Tu vis ! et tu vis ! les âges, Inégaux pour tes ouvrages, Sont tous égaux sous ta main ; Et jamais ta voix ne nomme, Hélas ! ces trois mots de l'homme : Hier, aujourd'hui, demain ! |
|
| Ô Père de la nature, Source, abîme de tout bien, Rien à toi ne se mesure, Ah ! ne te mesure à rien ! Mets, à divine clémence, Mets ton poids dans la balance, Si tu pèses le néant ! Triomphe, à vertu suprême ! En te contemplant toi-même, Triomphe en nous pardonnant !
|
|
| Voilà les feuilles sans sève Qui tombent sur le gazon, Voilà le vent qui s'élève Et gémit dans le vallon, Voilà l'errante hirondelle Qui rase du bout de l'aile L'eau dormante des marais, Voila l'enfant des chaumières Qui glâne sur les bruyères Le bois tombé des forêts. |
Suggestion de travail : comparer le texte complet avec la version de Brassens, que l’on fera écouter aux élèves. Quelles strophes Brassens a-t-il enlevées ? Quelle strophe a-t-il déplacée ? Quelle strophe a-t-il rajoutée ? Pourquoi ? Y a-t-il dans les strophes enlevées des éléments caractéristiques du romantisme lamartinien ou du romantisme en général ? Quelle est votre réaction face à ces strophes ?
Hugo, Odes et Ballades, La Légende de la nonne (1828)
La Vierge séduite
| {{{***version originale de Hugo}}} | {{{***version de Brassens}}} |
| Venez, vous dont l'oeil étincelle, Pour entendre une histoire encor, Approchez : je vous dirai celle De doña Padilla del Flor. Elle était d'Alanje, où s'entassent Les collines et les halliers. - Enfants, voici des boeufs qui passent, Cachez vos rouges tabliers ! |
Venez, vous dont l'oeil étincelle, Pour entendre une histoire encor, Approchez : je vous dirai celle De doña Padilla del Flor. Elle était d'Alanje, où s'entassent Les collines et les halliers. - Enfants, voici des boeufs qui passent, Cachez vos rouges tabliers ! |
| Il est des filles à Grenade, Il en est à Séville aussi, Qui, pour la moindre sérénade, À l'amour demandent merci ; Il en est que d'abord embrassent, Le soir, de hardis cavaliers. - Enfants, voici des boeufs qui passent, Cachez vos rouges tabliers ! |
Il est des filles à Grenade, Il en est à Séville aussi, Qui, pour la moindre sérénade, À l'amour demandent merci ; Il en est que d'abord embrassent, Le soir, de hardis cavaliers. - Enfants, voici des boeufs qui passent, Cachez vos rouges tabliers ! |
| Ce n'est pas sur ce ton frivole Qu'il faut parler de Padilla, Car jamais prunelle espagnole D'un feu plus chaste ne brilla ; Elle fuyait ceux qui pourchassent Les filles sous les peupliers. - Enfants, voici des boeufs qui passent, Cachez vos rouges tabliers ! |
Ce n'est pas sur ce ton frivole Qu'il faut parler de Padilla, Car jamais prunelle espagnole D'un feu plus chaste ne brilla ; Elle fuyait ceux qui pourchassent Les filles sous les peupliers. - Enfants, voici des boeufs qui passent, Cachez vos rouges tabliers ! |
| Rien ne touchait ce coeur farouche, Ni doux soins, ni propos joyeux ; Pour un mot d'une belle bouche, Pour un signe de deux beaux yeux, On sait qu'il n'est rien que ne fassent Les seigneurs et les bacheliers. - Enfants, voici des boeufs qui passent, Cachez vos rouges tabliers ! |
|
| Elle prit le voile à Tolède, Au grand soupir des gens du lieu, Comme si, quand on n'est pas laide, On avait droit d'épouser Dieu. Peu s'en fallut que ne pleurassent Les soudards et les écoliers. - Enfants, voici des boeufs qui passent, Cachez vos rouges tabliers ! |
Elle prit le voile à Tolède, Au grand soupir des gens du lieu, Comme si, quand on n'est pas laide, On avait droit d'épouser Dieu. Peu s'en fallut que ne pleurassent Les soudards et les écoliers. - Enfants, voici des boeufs qui passent, Cachez vos rouges tabliers ! |
| Mais elle disait : « Loin du monde, » Vivre et prier pour les méchants ! » Quel bonheur ! quelle paix profonde » Dans la prière et dans les chants ! » Là, si les démons nous menacent, » Les anges sont nos boucliers ! » - Enfants, voici des boeufs qui passent, Cachez vos rouges tabliers ! |
|
| Or, la belle à peine cloîtrée, Amour en son coeur s'installa. Un fier brigand de la contrée Vint alors et dit : Me voilà ! Quelquefois les brigands surpassent En audace les chevaliers. - Enfants, voici des boeufs qui passent, Cachez vos rouges tabliers ! |
Or, la belle à peine cloîtrée, Amour en son coeur s'installa. Un fier brigand de la contrée Vint alors et dit : Me voilà ! Quelquefois les brigands surpassent En audace les chevaliers. - Enfants, voici des boeufs qui passent, Cachez vos rouges tabliers ! |
| Il était laid : les traits austères, La main plus rude que le gant ; Mais l'amour a bien des mystères, Et la nonne aima le brigand. On voit des biches qui remplacent Leurs beaux cerfs par des sangliers. - Enfants, voici des boeufs qui passent, Cachez vos rouges tabliers ! |
Il était laid : les traits austères, La main plus rude que le gant ; Mais l'amour a bien des mystères, Et la nonne aima le brigand. On voit des biches qui remplacent Leurs beaux cerfs par des sangliers. - Enfants, voici des boeufs qui passent, Cachez vos rouges tabliers ! |
| Pour franchir la sainte limite, Pour approcher du saint couvent, Souvent le brigand d'un ermite Prenait le cilice et souvent La cotte de maille où s'enchâssent Les croix noires des Templiers. - Enfants, voici des boeufs qui passent, Cachez vos rouges tabliers ! |
|
| La nonne osa, dit la chronique, Au brigand par l'enfer conduit, Aux pieds de sainte Véronique Donner un rendez-vous la nuit, À l'heure où les corbeaux croassent, Volant dans l'ombre par milliers. - Enfants, voici des boeufs qui passent, Cachez vos rouges tabliers ! |
La nonne osa, dit la chronique, Au brigand par l'enfer conduit, Aux pieds de sainte Véronique Donner un rendez-vous la nuit, À l'heure où les corbeaux croassent, Volant dans l'ombre par milliers. - Enfants, voici des boeufs qui passent, Cachez vos rouges tabliers ! |
| Padilla voulait, anathème ! Oubliant sa vie en un jour, Se livrer, dans l'église même, Sainte à l'enfer, vierge à l'amour, Jusqu'à l'heure pâle où s'effacent Les cierges sur les chandeliers. - Enfants, voici des boeufs qui passent, Cachez vos rouges tabliers ! |
|
| Or quand, dans la nef descendue, La nonne appela le bandit, Au lieu de la voix attendue, C'est la foudre qui répondit. Dieu voulu que ses coups frappassent Les amants par Satan liés. - Enfants, voici des boeufs qui passent, Cachez vos rouges tabliers ! |
Or quand, dans la nef descendue, La nonne appela le bandit, Au lieu de la voix attendue, C'est la foudre qui répondit. Dieu voulu que ses coups frappassent Les amants par Satan liés. - Enfants, voici des boeufs qui passent, Cachez vos rouges tabliers ! |
| Aujourd'hui, des fureurs divines Le pâtre enflammant ses récits, Vous montre au penchant des ravines Quelques tronçons de murs noircis, Deux clochers que les ans crevassent, Dont l'abri tuerait ses béliers. - Enfants, voici des boeufs qui passent, Cachez vos rouges tabliers ! |
|
| Quand la nuit, du cloître gothique Brunissant les portails béants, Change à l'horizon fantastique Les deux clochers en deux géants ; À l'heure où les corbeaux croassent, Volant dans l'ombre par milliers... - Enfants, voici des boeufs qui passent, Cachez vos rouges tabliers ! |
|
| Une nonne, avec une lampe, Sort d'une cellule à minuit ; Le long des murs le spectre rampe, Un autre fantôme le suit ; Des chaînes sur leurs pieds s'amassent, De lourds carcans sont leurs colliers. - Enfants, voici des boeufs qui passent, Cachez vos rouges tabliers ! |
|
| La lampe vient, s'éclipse, brille, Sous les arceaux court se cacher, Puis tremble derrière une grille, Puis scintille au bout d'un clocher ; Et ses rayons dans l'ombre tracent Des fantômes multipliés. - Enfants, voici des boeufs qui passent, Cachez vos rouges tabliers ! |
|
| Les deux spectres qu'un feu dévore, Traînant leur suaire en lambeaux, Se cherchent pour s'unir encore, En trébuchant sur des tombeaux ; Leurs pas aveugles s'embarrassent Dans les marches des escaliers. - Enfants, voici des boeufs qui passent, Cachez vos rouges tabliers ! |
|
| Mais ce sont des escaliers fées, Qui sous eux s'embrouillent toujours ; L'un est aux caves étouffées, Quand l'autre marche au front des tours ; Sous leurs pieds, sans fin se déplacent Les étages et les paliers. - Enfants, voici des boeufs qui passent, Cachez vos rouges tabliers ! |
|
| Élevant leurs voix sépulcrales, Se cherchant les bras étendus, Ils vont... Les magiques spirales Mêlent leurs pas toujours perdus ; Ils s'épuisent et se harassent En détours, sans cesse oubliés. - Enfants, voici des boeufs qui passent, Cachez vos rouges tabliers ! |
|
| La pluie alors, à larges gouttes, Bat les vitraux frêles et froids ; Le vent siffle aux brèches des voûtes ; Une plainte sort des beffrois ; On entend des soupirs qui glacent, Des rires d'esprits familiers. - Enfants, voici des boeufs qui passent, Cachez vos rouges tabliers ! |
|
| Une voix faible, une voix haute, Disent : « Quand finiront les jours ? Ah ! nous souffrons par notre faute ; Mais l'éternité, c'est toujours ! Là, les mains des heures se lassent À retourner les sabliers... » - Enfants, voici des boeufs qui passent, Cachez vos rouges tabliers ! |
|
| L'enfer, hélas ! ne peut s'éteindre. Toutes les nuits, dans ce manoir, Se cherchent sans jamais s'atteindre Une ombre blanche, un spectre noir, Jusqu'à l'heure pâle où s'effacent Les cierges sur les chandeliers. - Enfants, voici des boeufs qui passent, Cachez vos rouges tabliers ! |
|
| Si, tremblant à ces bruits étranges, Quelque nocturne voyageur, En se signant demande aux anges Sur qui sévit le Dieu vengeur, Des serpents de feu qui s'enlacent Tracent deux noms sur les piliers. - Enfants, voici des boeufs qui passent, Cachez vos rouges tabliers ! |
|
| Cette histoire de la novice, Saint Ildefonse, abbé, voulut Qu'afin de préserver du vice Les vierges qui font leur salut, Les prieures la racontassent Dans tous les couvents réguliers. - Enfants, voici des boeufs qui passent, Cachez vos rouges tabliers ! Avril 1828. |
Cette histoire de la novice, Saint Ildefonse, abbé, voulut Qu'afin de préserver du vice Les vierges qui font leur salut, Les prieures la racontassent Dans tous les couvents réguliers. - Enfants, voici des boeufs qui passent, Cachez vos rouges tabliers ! |
Ce texte n’est pas exempt d’un certain détachement humoristique à l’égard de la légende, qui a séduit Brassens : on pourra faire écouter la chanson aux élèves, en essayant de faire mesurer le sens du découpage de Brassens : on pourra par exemple demander aux élèves :
– ce qui produit ce détachement dans le deux textes
– quels aspects du romantisme (ou du roman noir en l’occurrence) ont été éliminés par Brassens
– quelles sont les contraintes liées au genre,
– et si le système de valeurs implicite est le même chez Hugo et chez Brassens.
Le texte de Hugo peut être récupéré sur le cédérom Le siècle de Victor Hugo. La sélection de Brassens se trouve un peu partout sur Internet. Sur Brassens, on pourra se reporter à un site canadien qui donne une présentation rapide du chanteur poète et une discographie complète.
Eugénie de Guérin, Journal (1834-1840), éd. de 1864
Lettre sur la mort de la jeune fille
Le 17 novembre 1834 (à son frère Maurice)
Trois lettres depuis hier, trois plaisirs bien grands, car j’aime tant les lettres et celles qui m’écrivent : c’est Louise, Mimi et Félicité. Cette chère Mimi me dit de charmantes et douces choses sur notre séparation, sur son retour, sur son ennui, car elle s’ennuie loin de moi comme je m’ennuie sans elle. à tout moment, je vois, je sens qu’elle me manque, surtout la nuit où j’ai l’habitude de l’entendre respirer à mon oreille. Ce petit bruit me porte sommeil. Ne pas l’entendre me fait penser tristement. Je pense à la mort, qui fait aussi tout taire autour de nous, qui sera aussi une absence. Ces idées de la nuit me viennent un peu de celles du jour. On ne parle que maladies, que morts ; la cloche d’Andillac n’a sonné que des glas ces jours-ci. C’est la fièvre maligne qui fait ses ravages comme tous les ans. Nous pleurons tous une jeune femme de ton âge, la plus belle, la plus vertueuse de la paroisse, enlevée en quelques jours. Elle laisse un tout petit enfant qui tétait. Pauvre petit ! C’était Marianne De Gaillard. Dimanche dernier j’allai encore serrer la main à une agonisante de dix-huit ans. Elle me reconnut, la pauvre jeune fille, me dit un mot et se remit à prier Dieu. Je voulais lui parler, je ne sus que lui dire ; les mourants parlent mieux que nous. On l’enterrait lundi. Que de réflexions à faire sur ces tombes fraîches ! ô mon dieu, que l’on s’en va vite de ce monde ! Le soir, quand je suis seule, toutes ces figures de morts me reviennent. Je n’ai pas peur, mais mes pensées prennent toutes le deuil, et le monde me paraît aussi triste qu’un tombeau. Je t’ai dit cependant que ces lettres m’avaient fait plaisir. Oh ! C’est bien vrai ; mon coeur n’est pas muet au milieu de ces agonies, et ne sent que plus vivement tout ce qui lui porte vie. Ta lettre donc m’a donné une lueur de joie, je me trompe, un véritable bonheur, par les bonnes choses dont elle est remplie. Enfin ton avenir commence à poindre ; je te vois un état, une position sociale, un point d’appui à la vie matérielle. Dieu soit loué ! C’est ce que je désirais le plus en ce monde et pour toi et pour moi, car mon avenir s’attache au tien, ils sont frères. J’ai fait de beaux rêves à ce sujet, je te les dirai peut-être. Pour le moment, adieu ; il faut que j’écrive à Mimi.
Auguste BARBIER (1805-1882 ), Iambes (1830),La Curée
La Femme-liberté
III
C’est que la liberté n’est pas une comtesse
Du noble Faubourg Saint-Germain,
Une femme qu’un cri fait tomber en faiblesse,
Qui met du blanc et du carmin :
C’est une forte femme aux puissantes mamelles,
A la voix rauque, aux durs appas,
Qui, du brun sur la peau, du feu dans les prunelles,
Agile et marchant à grands pas,
Se plaît aux cris du peuple, aux sanglantes mêlées,
Aux longs roulements des tambours,
A l’odeur de la poudre, aux lointaines volées
Des cloches et des canons sourds ;
Qui ne prend ses amours que dans la populace,
Qui ne prête son large flanc
Qu’à des gens forts comme elle, et qui veut qu’on l’embrasse
Avec des bras rouges de sang.
IV
C’est la vierge fougueuse, enfant de la Bastille,
Qui jadis, lorsqu’elle apparut
Avec son air hardi, ses allures de fille,
Cinq ans mit tout le peuple en rût ;
Qui, plus tard, entonnant une marche guerrière,
Lasse de ses premiers amants,
Jeta là son bonnet, et devint vivandière
D’un capitaine de vingt ans :
C’est cette femme, enfin, qui, toujours belle et nue,
Avec l’écharpe aux trois couleurs,
Dans nos murs mitraillés tout à coup reparue,
Vient de sécher nos yeux en pleurs,
De remettre en trois jours une haute couronne
Aux mains des français soulevés,
D’écraser une armée et de broyer un trône
Avec quelques tas de pavés.
George Sand, Indiana (1832, éd. revue et corrigée en 1842)
A travers ce personnage, George Sand dénonce ici à la fin du chapitre XVIII la place réservée à la femme dans le couple
Indiana (...) souffrit horriblement de se voir négligée ; cependant elle eut encore le bonheur de ne pas s’avouer la ruine entière de ses espérances. Elle était facile à tromper ; elle ne demandait qu’à l’être, tant sa vie réelle était amère et désolée ! Son mari devenait presque insociable En public, il affectait le courage et l’insouciance stoïque d’un homme de coeur ; rentré dans le secret de son ménage, ce n’était plus qu’un enfant irritable, rigoriste et ridicule. Indiana était la victime de ses ennuis, et il y avait, nous l’avouerons, beaucoup de sa propre faute. Si elle eût élevé la voix, si elle se fût plainte avec affection, mais avec énergie, Delmare, qui n’était que brutal, eût rougi de passer pour méchant. Rien n’était plus facile que d’attendrir son coeur et de dominer son caractère, quand on voulait descendre à son niveau et entrer dans le cercle d’idées qui était à la portée de son esprit. Mais Indiana était roide et hautaine dans sa soumission ; elle obéissait toujours en silence ; mais c’était le silence et la soumission de l’esclave qui s’est fait une vertu de la haine et un mérite de l’infortune. Sa résignation, c’était la dignité d’un roi qui accepte des fers et un cachot, plutôt que d’abdiquer sa couronne et de se dépouiller d’un vain titre. Une femme de l’espèce commune eût dominé cet homme d’une trempe vulgaire ; elle eût dit comme lui et se fût réservé le plaisir de penser autrement ; elle eût feint de respecter ses préjuges, et elle les eût foulés aux pieds en secret ; elle l’eût caressé et trompé. Indiana voyait beaucoup de femmes agir ainsi ; mais elle se sentait si au-dessus d’elles qu’elle eût rougi de les imiter.Vertueuse et chaste, elle se croyait dispensée de flatter son maître dans ses paroles, pourvu qu’elle le respectât dans ses actions. Elle ne voulait point de sa tendresse, parce qu’elle n’y pouvait pas répondre. Elle se fût regardée comme bien plus coupable de témoigner de l’amour à ce mari qu’elle n’aimait pas, que d’en accorder à l’amant qui lui en inspirait. Tromper, c’était là le crime à ses veux, et vingt fois par jour elle se sentait prête à déclarer qu’elle aimait Raymon ; la crainte seule de perdre Raymon la retenait. Sa froide obéissance irritait le colonel bien plus que ne l’eût fait une rébellion adroite. Si son amour-propre eût souffert de n’être pas le maître absolu dans sa maison, il souffrait bien davantage de l’être d’une façon odieuse ou ridicule. Il eût voulu convaincre, et il ne faisait que commander ; régner, et il gouvernait. Parfois il donnait chez lui un ordre mal exprimé, ou bien il dictait sans réflexion des ordres nuisibles à ses propres intérêts. Madame Delmare les faisait exécuter sans examen, sans appel, avec l’indifférence du cheval qui traîne la charrue dans un sens ou dans l’autre. Delmare, en voyant le résultat de ses idées mal comprises, de ses volontés méconnues, entrait en fureur ; mais, quand elle lui avait prouvé d’un mot calme et glacial qu’elle n’avait fait qu’obéir strictement à ses arrêts, il était réduit à tourner sa colère contre lui-même. C’était pour cet homme, petit d’amour-propre et violent de sensations, une souffrance cruelle, un affront sanglant. Alors il eût tué sa femme s’il eût été à Smyrne ou au Caire. Et pourtant il aimait au fond du coeur cette femme faible qui vivait sous sa dépendance et gardait le secret de ses torts avec une prudence religieuse. Il l’aimait ou il la plaignait, je ne sais lequel. Il eût voulu en être aimé ; car il était vain de son éducation et de sa supériorité. Il se fût élevé à ses propres yeux si elle eût daigné s’abaisser jusqu’à entrer en capitulation avec ses idées et ses principes. Lorsqu’il pénétrait chez elle le matin avec l’intention de la quereller, il la trouvait quelquefois endormie, et il n’osait pas l’éveiller. Il la contemplait en silence ; il s’effrayait de la délicatesse de sa constitution, de la pâleur de ses joues, de l’air de calme mélancolique, de malheur résigné, qu’exprimait cette figure immobile et muette. Il trouvait dans ses traits mille sujets de reproche, de remords, de colère et de crainte ; il rougissait de sentir l’influence qu’un être si frêle avait exercée sur sa destinée, lui, homme de fer, accoutumé à commander aux autres, à voir marcher à un mot de sa bouche les lourds escadrons, les chevaux fougueux, les hommes de guerre.
Une femme encore enfant l’avait donc rendu malheureux ! Elle le forçait de rentrer en lui-même, d’examiner ses volontés, d’en modifier beaucoup, d’en rétracter plusieurs, et tout cela sans daigner lui dire : « Vous avez tort ; je vous prie de faire ainsi. » Jamais elle ne l’avait imploré, jamais elle n’avait daigné se montrer son égale et s’avouer sa compagne. Cette femme, qu’il aurait brisée dans sa main s’il eût voulu, elle était là, chétive, rêvant d’un autre peut-être sous ses yeux, et le bravant jusque dans son sommeil. Il était tenté de l’étrangler, de la traîner par les cheveux, de la fouler aux pieds pour la forcer de crier merci, d’implorer sa grâce ; mais elle était si jolie, si mignonne et si blanche, qu’il se prenait à avoir pitié d’elle, comme l’enfant s’attendrit à regarder l’oiseau qu’il voulait tuer. Et il pleurait comme une femme, cet homme de bronze, et il s’en allait pour qu’elle n’eût pas le triomphe de le voir pleurer. En vérité, je ne sais lequel était plus malheureux d’elle ou de lui. Elle était cruelle par vertu, comme il était bon par faiblesse ; elle avait de trop la patience qu’il n’avait pas assez ; elle avait les défauts de ses qualités, et lui les qualités de ses défauts.











